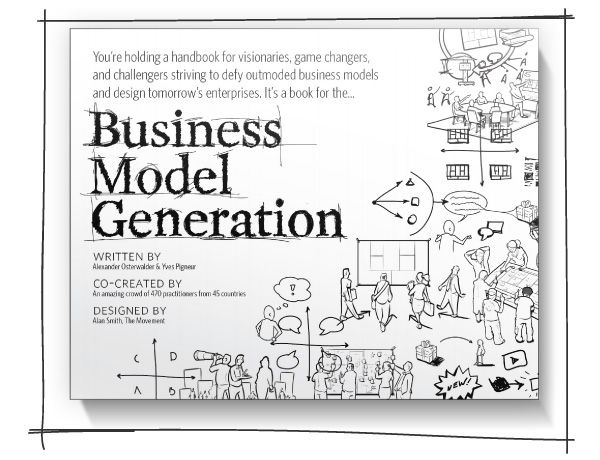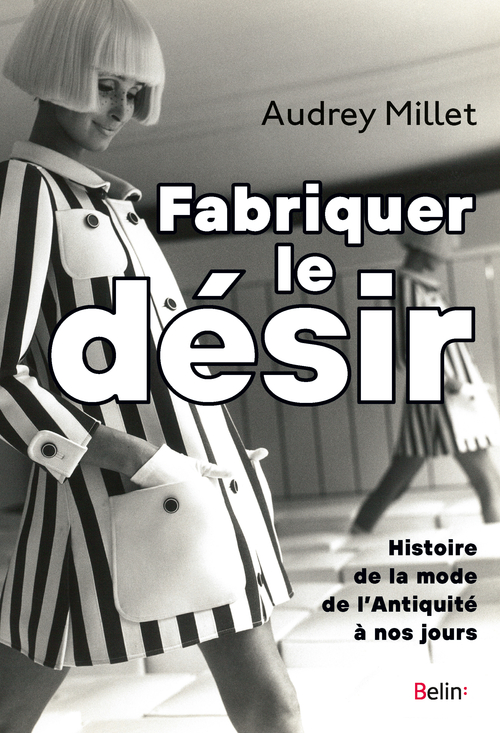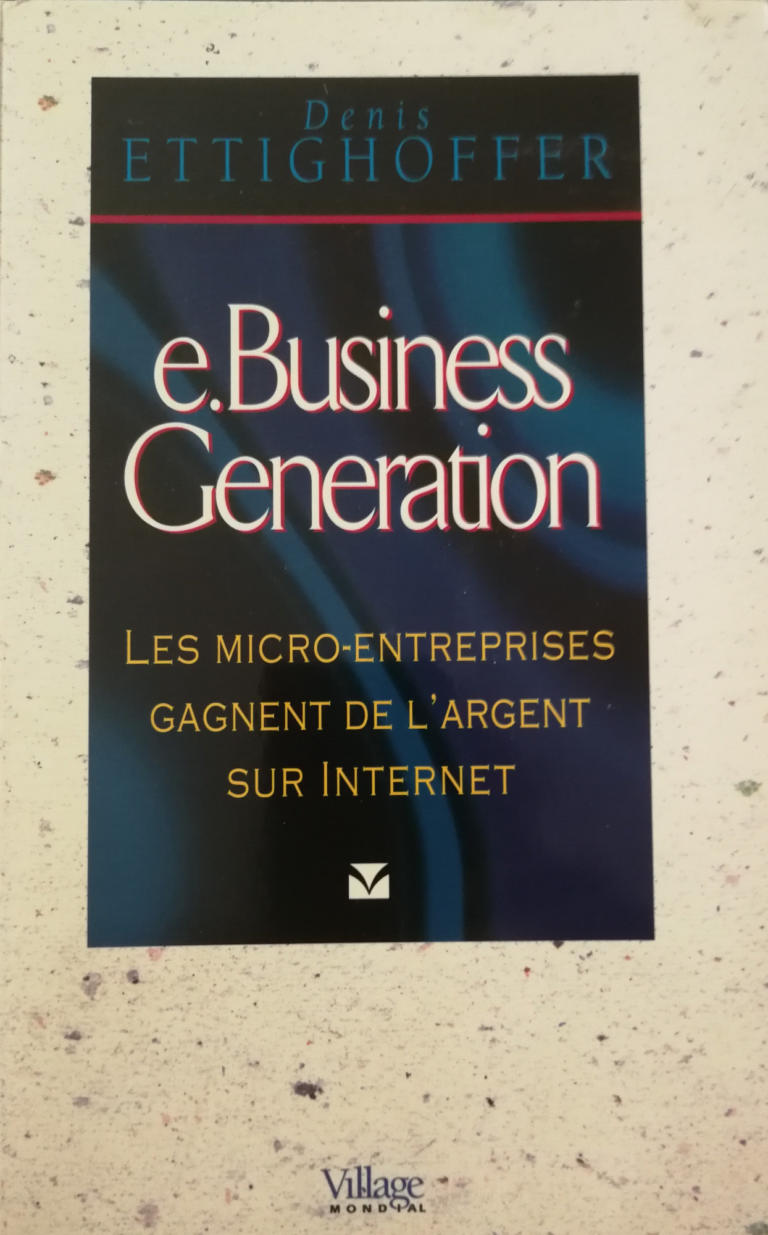La première fois que j’ai fait allusion à l’idée que la formation entrait dans la sphère marchande à l’occasion d’une conférence devant des enseignants fin des années 90,il y a eu, je puis vous l’affirmer, des mouvements divers dans la salle. J’y affirmais que l’acquisition des connaissances passait d’une logique « poussée » à une logique « tirée » : Elle entrait dans la sphère marchande. Ci-dessous un extrait de Netbrain 2000.
Nous sommes désormais dans un monde qui est passé du « travail sans frontières aux frontières du savoir ». L’économie du futur s’installe dans les réseaux de compétences des filières professionnelles. La puissance économique du 21e siècle se constitue au travers de la robustesse de réseaux de compétences fédérés. Les frontières de l’entreprise, de la nation, la composition géoéconomique classique sont mises à mal par des réseaux qui ne s’embarrassent guère des postes de douanes. La géostratégie des savoirs et des échanges numériques s’établit sur la base de données absolument nouvelle. Avec la globalisation, les enjeux politiques et économiques changent. Les régions savantes vont s’allier aux réseaux savants. Une part croissante de la population mondiale devient citoyenne d’un cybercontinent où chacun s’organise au gré de ses aspirations pour se relier avec sa ou ses communautés virtuelles de prédilection tout en établissant entre eux de fortes relations interactives. La numérisation amène à ceci, que nous devenons par la force des choses une société où les savoirs circulent sous forme de biens numériques dans les réseaux. Un savoir qui se vend ! De même que pour certaines ressources matérielles, l’accès aux connaissances se met à fonctionner en « juste à temps ».
La bagarre sur la commercialisation des savoirs commence. L’enjeu est important. Selon les derniers chiffres de Nielsen / Netratings, la recherche d’information sur le Web auraient augmenté de 55% entre les mois de décembre 2004 et 2005, passant de 3,3 milliards de recherches mensuelles à 5,1 milliards. Google tente de reprendre la main par le lancement d’un portail permettant de stocker les vidéos personnelles des internautes. Un moteur spécialisé donne à chaque internaute la possibilité de chercher dans le tas pour s’en servir à sa guise, non sans payer. Selon toute vraisemblance cet argent servira à payer les droits de copyright que se partageront « l’éditeur libre » et Google. Et Yahoo de rétorquer, après avoir racheté le site de sauvegarde « del.icio.us », en mettant à la disposition des internautes la possibilité de sauvegarder leurs blogs pour la postérité et … sa prospérité. Mais voilà que Google relance avec sa place de marché : Google Base. Elle sera sans doute disponible en France le jour où sortira cet ouvrage. Contrairement à ce qui a été écrit parfois, l’ambition de Google Base va plus loin que la saisie d’annonces ou la promotion d’événements permettant de collecter des fonds. Google Base va permettre aux internautes savants de vendre du contenu à valeur ajoutée, des services et des compétences en ligne. Avec cette dernière application nous avons l’illustration de l’émergence d’un outil de transaction des savoirs par et pour les particuliers. Il y a de grandes chances qu’il soit aussi efficace que l’est eBay pour les enchères des objets matériels. Affaire à suivre, à suivre avec d’autant plus d’attention que les innovations en matière de commercialisation des savoirs, représenteront à terme une expérience inestimable pour l’entreprise et le pays qui en fait un modèle économique.
Ce n’est donc pas en constituant des « bantoustans de l’économie » que l’on pourra développer nos entreprises, mais en constituant des « réseaux savants » thématiques. La netéconomie incite à la construction de « «pays virtuels » qui organisent leurs économies par affinités socioprofessionnelles et culturelles. L’idée générale consistant à fédérer les différents maillons d’une chaîne professionnelle pour améliorer le fonctionnement des interfaces mais surtout pour favoriser et intensifier les échanges de connaissances. Il s’agit moins de se désoler des délocalisations que d’analyser les équilibres avantages/ inconvénients que les firmes ont fait de leurs géo-localisations et d’en tirer parti pour préserver des avantages compétitifs. Parmi ces avantages nous trouvons la capacité pour certaines régions, pour certaines entreprises ou réseaux professionnels à capitaliser mieux que d’autres la matière grise et à la valoriser. Au final, soutenir les réseaux d’excellence professionnels revient à soutenir des leviers économiques du développement durable et la présence française dans les réseaux d’affaires internationaux. Les batailles économiques à venir ne seront pas sur nos frontières. Ce sera une bataille de l’intelligence et elle aura lieu dans les réseaux savants.
Les débuts prometteurs des « bourses des savoirs » Des canaux de commercia-lisation des savoirs d’un type entièrement nouveau émergent afin de contribuer à réguler l’offre et la demande des connaissances: les bourses de savoirs complèteront les places de marchés virtuelles internationales. La première des bourses des savoirs est née aux Etats-Unis au début du 21ème siècle. Une histoire qui débute par une question toute simple que se sont posés ses dirigeants à la fin des années 1990 : Comment Eli Lilly, une des plus grandes entreprises pharmaceutiques américaines et mondiales, continuera-t-elle à gagner de l’argent quand le Prozac sera tombé dans le domaine public ? Certes il fallait poursuivre des efforts de recherche pour mettre au point de nouveaux médicaments. Mais Alph Bingham, ancien vice-président de l’entreprise, s’est demandé si l’on pouvait poser à des milliers de chercheurs dans le monde les problèmes auxquels s’attaquaient les 7 500 chercheurs de ses laboratoires. Des milliers de brillants esprits étaient tous accessibles grâce à Internet, un gisement de matière grise fabuleux était à la portée de son entreprise. Pour ce dernier, cela ressemblait à ce qui passe à la radio : « Posez la question : « qui a terminé troisième à Indianapolis en 1938 ? » et en 2 minutes quelqu’un vous téléphone la réponse ». C’est en 2001 que les patrons d’Ely Lilly décidèrent de mettre l’idée à l’épreuve en investissant quelques millions de dollars dans une start-up sur Internet appelée InnoCentive, contraction d’Innovation Incentive, incitation à l’innovation[1]. Deux autres entreprises, Dow et Procter & Gamble, joignirent Eli Lilly très rapidement. Quand le premier problème de la « Bourse des Savoirs » d’Innocentive a été affiché en juillet 2001, une des premières solutions est venue en moins de 72 heures d’un chimiste spécialisé dans le pétrole travaillant au Kazakhstan. La plupart des entreprises n’auraient jamais recruté Michael Cash, âgé de 28 ans, jeune diplômé de l’université de Géorgie, pour découvrir un composé similaire au tryptophane (un acide aminé) moins coûteux et plus facile à produire. «J’ai eu instantanément l’idée pour résoudre le problème[2]» déclara celui-ci qui a résolu en deux semaines le problème posé. InnoCentive a conclu des partenariats avec de nombreuses entreprises et aurait une trentaine de clients. InnoCentive garantit la fiabilité et la légitimité des entreprises qui affichent des demandes et proposent des récompenses. Elle travaille avec des entreprises qui ont formulé une politique des droits de la propriété intellectuelle et qui l’ont rendue publique. Les entreprises contactent InnoCentive en se déclarant « demandeuses » (seekers) et publient sur Internet leurs problèmes de R&D. Un département d’InnoCentive aide les entreprises qui le souhaitent à formuler leur question tout en préservant leur anonymat. Il s’assure que les exigences légales, scientifiques et commerciales classiques sont vérifiées. Les problèmes sont mis en ligne sur le site avec un résumé de la demande, une date limite de réponse et le montant de la récompense attribuée à la meilleure solution (entre 2000 et 100 000$). Pour afficher une demande, l’entreprise demandeuse paie un acompte à InnoCentive, en général autour de 2000$. Pour avoir plus de précisions sur la demande, il faut être préalablement inscrit comme découvreur de solution (solver). Les scientifiques du monde entier sont éligibles. Ils doivent s’inscrire en remplissant un formulaire en ligne et accepter un règlement émis par InnoCentive. C’est là qu’est précisée la politique de non-divulgation de la solution et de transfert des droits de propriété intellectuelle. Cette formalité permet d’accéder à la description détaillée des problèmes et aux critères de soumission de la solution.
Le site Innocentive.com sert de forum d’échanges. Un peu moins d’une centaine de problèmes restent soumis en permanence à la sagacité des chercheurs. InnoCentive a créé un espace sécurisé en ligne appelé Project Room (salle des projets) qui contient les détails et exigences diverses liés à chaque problème. C’est là que se déroulent les échanges entre les chercheurs et les membres d’InnoCentive responsables du problème posé. Les chercheurs soumettent leurs solutions directement à InnoCentive par l’intermédiaire de la Project Room qui leur a été attribuée. InnoCentive s’occupe de l’évaluation de la solution ; six de ses scientifiques aident les entreprises clientes à passer en revue les solutions proposées et à sélectionner la meilleure. Plus de 25 000 scientifiques se sont enregistrés comme « apporteurs de solutions » pour examiner les questions et soumettre leurs solutions en ligne. Le site existe en anglais, chinois, allemand, russe, espagnol, japonais et coréen. Les scientifiques inscrits proviennent de plus d’une centaine de pays. Plus de la moitié (53%) habitent en dehors des USA. Ainsi le département de chimie de l’université d’État de Moscou a trouvé sur le site d’InnoCentive nombre de problèmes qui l’intéressaient. Au départ, la chimie était la seule discipline concernée. Puis l’expérience s’est étendue à d’autres disciplines et comprenait début novembre 2003 : pharmacie, biotechnologie, agrobusiness, produits de grande consommation, plastiques et polymères, saveurs et parfums alimentaires, chimie de base, chimie diversifiée, pétrochimie et chimie de spécialité (l’ordre est celui utilisé sur le site). À l’intérieur de la chimie, les demandes relèvent de plusieurs branches : chimie organique théorique, biochimie, travaux sur l’ADN, plantes transgéniques, produits de grande consommation, analyses chimiques, tests de matériaux, etc. Des demandes sont affichées à la fois en chimie et en biologie. En octobre 2003, InnoCentive avait attribué à 47 scientifiques des sommes qui s’élèvent à 537 280 $. Un scientifique polonais a gagné deux fois 75000$[3], c’est un record ! Environ 40% des problèmes ont été résolus, selon Darren Carroll[4], PDG d’InnoCentive. Huit défis résolus sont affichés sur le site. Une biographie des chercheurs correspondants est affichée.
Grâce à la puissance du cerveau planétaire, InnoCentive a révolutionné la manière de penser et de mener la R&D. Cette formule permet aux scientifiques de recevoir une reconnaissance publique et une récompense financière pour avoir résolu des défis de R&D. Selon Darren Carroll, «quoique l’argent obtenu en résolvant un problème soit agréable, la plupart des scientifiques qui se penchent sur les problèmes proposés le font par goût du défi intellectuel qu’ils représentent.[5]». Elle permet aux entreprises de puiser des talents dans la communauté scientifique mondiale pour trouver des solutions innovantes à de difficiles problèmes de R&D. Pour Eli Lilly, InnoCentive fait plus que tripler son nombre de chercheurs sans les avoir comme salariés. Dans Biotech, Darren Carroll a précisé les attraits de la formule pour les entreprises : «Il y a dans le monde plus d’un million de docteurs en biologie et en chimie, mais aucune entreprise ni aucune université ne peut faire travailler à son compte plus de 1% de cette base de talents. Imaginez l’augmentation de productivité qui pourrait avoir lieu si les entreprises étaient en mesure de mettre en valeur à leur profit cette puissance cérébrale. […] Ce qu’offre InnoCentive, ce n’est pas un remplaçant des efforts de R&D des entreprises, mais un complément[6]». Depuis d’autres expériences sont en cours de développement aux Etats-Unis sans qu’aucune étude n’ait été lancée à notre connaissance sur l’intérêt d’évaluer cette approche en France. L’idée du commerce des connaissances n’est pas encore arrivée ici.
La montée en puissance du courtage des savoirs. Les patrimoines intellectuels entrent dans la sphère marchande et les besoins d’intermédiations fleurissent partout. La valorisation de la matière grise, des actifs immatériels des entreprises, devient affaire de spécialistes. Les magazines multiplient les éditions spéciales sur les stratégies des ventes de licences. Le récent forum de l’innovation du magazine Fortune à New York a du refuser du monde tellement il y avait de demande d’inscriptions. Contraste, en France, une étude de 2003 du cabinet KPMG montre que 27% seulement des entreprises européennes considèrent la propriété industrielle comme une source possible de revenus et 16% que cela pouvait être un outil stratégique. Le déficit de sensibilisation y est pour beaucoup. Sans doute faudra t-il des initiatives énergiques des pouvoirs publics avant que cela ne se transforme en déficit dans la balance des paiements. Sans compter les dégâts occasionnés par la perte d’attractivité vis à vis des investisseurs de plus en plus attirés par les entreprises et les secteurs d’activités innovants. Une enquête du BTG International, un fond d’investissement en technologies et sciences de la vie dont on parle beaucoup actuellement, montre que 67% des compagnies américaines possèdent des actifs technologiques qu’elles n’exploitent pas[7]. Mais c’est vrai aussi au Japon. Les Japonais constatent depuis la fin des années 90 une diminution des recettes des licences, le professeur Masatoshi Koshiba, prix Nobel de physique répondant à une interview du Nihon Keizai Shimbun, déplore le manque de « système d’évaluation de la recherche » et le mauvais parti tiré des innovations japonaises[8]. Une mésaventure dont sera victime Toshiba au début des années 80 illustre parfaitement le point de vue de Masatoshi Koshiba. A l’époque, un ingénieur de Toshiba, Fujio Masuoka, a conçu un microprocesseur capable de conserver les informations même éteint : la mémoire flash était née. Toshiba ne croît pas au produit et plutôt que l’exploiter cède sans trop de précautions la technique à Intel. L’américain mettra une équipe importante sur le projet. Rapidement mis au point, Intel contrôle désormais 30% du marché des mémoires flash loin devant Toshiba qui ne peut plus rattraper son retard. Un retard accentué par le fait des brevets complémentaires déposés cette fois ci par Intel.
Si certaines entreprises s’aperçoivent qu’elles ne valorisent pas suffisamment leurs savoirs, d’autres comme dans le secteur de la pharmacie sont en train de perdre des rentes, leurs brevets tombant dans le domaine public. On peut observer aussi une accumulation coûteuse et improductive de brevets. Le maintien de la protection de quelques centaines de brevets mobilise des budgets conséquents et ces coûts vont augmenter dans les années à venir compte tenu de la complexité croissante des contrôles. C’est sur la base de ce constat qu’en 2002, Mark Bernstein prendra la tête du centre de Parc.Inc, nouveau nom du centre d’innovation à Palo Alto de Rank Xerox. Une orientation en centre de profit de ce qui a été longtemps considéré comme une formidable boite à idées de la Californie et de l’industrie informatique, mais incapable – disait-on volontiers – d’en tirer des avantages monétaires. Le Parc regroupe 185 chercheurs interdisciplinaires venus de 25 pays qui s’attaqueront à des sujets plus ouverts comme les sciences biomédicales[9]. Le marché est suffisamment alléchant pour financer le Parc. Le chiffre d’affaires des cessions de licences a progressé de 633% sur la dernière décennie et devrait, selon les experts, atteindre la somme de 500 milliards de dollars dans les dix ans à venir[10]. Ce sont généralement des spécialistes maison qui valorisent le portefeuille des actifs en question, comme chez Xerox ou IBM, mais ce n’est pas toujours le cas. Les marchés des échanges et des transactions d’innovation se développent maintenant rapidement grâce à des sociétés de courtage spécialisées. En octobre 2001, le Centre de Recherches sur les Communications Canadien (CRC), laboratoire comptant parmi les chefs de file mondiaux de la recherche en télécommunications, et BTG, société internationale de commercialisation de technologies, ont annoncé avoir conclu une entente en vertu de laquelle BTG aidera le CRC à commercialiser ses technologies brevetées. Chaque fois que BTG acceptera une proposition du CRC, elle disposera alors des droits exclusifs de commercialisation de la technologie en question auprès d’entreprises, d’abord au Canada, puis à l’échelle mondiale. Le CRC et BTG se partageront les redevances résultant de l’attribution de sous licences.
En France, Philippe ADNOT, Sénateur, rapporteur spécial d’une étude sur la valorisation de la recherche dans les universités conduite en 2005/2006 s’est attachée à cerner les principaux obstacles de la valorisation de la recherche dans les universités. Il notera pour nous mettre immédiatement dans l’ambiance que le principe de valorisation de la R&D dans les universités était prévu dans les textes depuis… 1982 ! Il faudra attendre les textes d’applications qui sortiront en… 1999 pour entrer dans le vif du sujet. C’est à dire que la plupart des textes sont inapplicables. On dirait en informatique que le programme était « buggé » d’entrée ! La valorisation correspond aux moyens de « rendre utilisables ou commercialisables les résultats, les connaissances et les compétences de la recherche ». Ensuite, elle suppose une mise en relation du monde de la recherche et du monde socio-économique qui doit être organisée et faire l’objet d’actions concertées et réfléchies. Enfin, troisième élément déterminant la valorisation doit « offrir la possibilité de tirer le meilleur parti de l’engagement de l’Etat en faveur de la recherche en faisant en sorte que la société bénéficie des résultats de cette recherche ». Le rapporteur ne manque pas de souligner l’enjeu de cette valorisation dans une économie du savoir où la compétition internationale se joue sur l’exploitation de la «matière grise ». Pour constater aussitôt que cette valorisation de la R&D ne se fait pas « faute de ressources suffisantes ou de mécanismes appropriés ». Et de citer l’exemple du Québec qui a mis en place, à la fin des années 90, un dispositif ambitieux de valorisation appuyé par des moyens financiers importants. Ce dispositif a été nommé «Valorisation Recherche Québec». Les moyens dégagés ont notamment servi à créer quatre sociétés de valorisation (Univalor, Sovar, MSBi, Valéo) qui ne sont ni plus ni moins que des courtiers en innovation. Ces sociétés commercialisent les trouvailles des centres universitaires, grandes écoles centres hospitaliers (voir aussi les réseaux d’excellences) et organismes affiliés. Elles ont pour mission d’accompagner le chercheur dans la chaîne de valorisation, de la déclaration d’invention jusqu’au transfert technologique. L’intérêt de ces organismes encore récent est de pouvoir prendre en charge les relations complexes qui s’établissent dans une chaîne innovante entre des universitaires, des écoles, des laboratoires privés ou publics, d’assurer la gestion des dépôts de brevet et le suivi des licences. Une chance de plus de pouvoir valoriser des idées et des brevets qui sinon ne seraient pas connus d’utilisateurs potentiels dans le secteur privé notamment. On peut très bien envisager que certains de ces organismes soient soutenus par des régions afin de « porter » des brevets du secteur publics comme des fonds spécialisés « portent » des actions. En tous cas le secteur privé ne s’en prive pas.
La firme de courtage privée japonaise Zurich Securities a créé en 2003, un nouveau fond destiné à racheter les brevets aux entreprises alors que de leur côté des laboratoires indiens se sont mis à embaucher une armada d’avocats pour pouvoir pénétrer les marchés américains avec des génériques. Selon le Wall Street Journal du 30 avril 2003, des brevets du secteur vont tomber dans le domaine public et ouvrir un marché aux génériques estimé à quelques 55 milliards d’euros. Les fabricants indiens de génériques passent au crible les brevets susceptibles d’être copiés ou contournés. Très récemment Sanofi-Aventis a lancé un procès contre les laboratoires Amphastar et Teva qui souhaitaient lancer aux Etats-Unis une version générique de leur Lovenox (un anticoagulant). Des laboratoires indiens vont jusqu’à former des scientifiques aux arcanes de la protection industrielle pour se battre mieux contre les brevets des concurrents occidentaux. Ces derniers habitués à dominer les marchés sont sur la défensive alors qu’une paix armée s’installe pour protéger les droits de propriété intellectuelle. Les stratégies de l’économie des connaissances se préparent dans les cabinets des conseils en propriété industrielle. L’astuce stratégique pour les génériques consiste à mettre sur le marché leurs solutions bons marchés avant la fin des droits des brevets d’origine. Comme le droit de brevets est moins protecteur aux USA, le temps que les victimes de la contrefaçon est sorti l’artillerie juridique celle ci a eut le temps de se faire un nom et de se positionner sur la marché en accélérant l’obsolescence du médicament de son concurrent qui perd en quelques mois 60 à 90% de son chiffre d’affaires. Alors l’inventeur des molécules d’origines porte plainte pour contrefaçon. Mais voilà, les associations de consommateurs et les assurances maladies qui cherchent sans cesse des produits low cost se liguent alors contre les laboratoires qui tentent de bloquer le générique remplaçant leurs protégés. Pour limiter la casse les laboratoires conduisent une tactique de harcèlement juridique en propriété intellectuelle où une simple molécule mise sur le marché peut être protégé jusqu’à 120 brevets à l’exemple de l’anticoagulant Lovenox[11]. Nous passons des batailles de la corbeille aux batailles juridiques. Les compétitions à venir de l’économie de la connaissance ne seront pas une carte du tendre. (Extraits de Netbrain 2001)
[1] Business Development, InnoCentive Inc., 35 New England Business Center, Andover, Mass., USA, www.innocentive.com
[2] Karen Lowry Miller, “Ideas Wanted”, NewsWeek, 30 juin 2003.
[3] ibid.
[4] Dyke Hendrickson, “World-class solutions”, Mass. High Tech, 24 février 2003.
[5] Nancy Weil, « InnoCentive pairs R&D challenges with researchers”, Bio-IT World News, 29 mai 2003.
[6] Biotech, Vol.1, n°4, novembre 2002.
[7] BTG International, société londonienne de gestion de portefeuilles de brevets technologiques, attaque Apple et Microsoft pour violation de brevets appartenant à la société Teleshuttle.
[8] Voir Courrier International du 5 février 2003
[10] « La puissance caché des brevets », Kevin G.Rivette et David Kline, L’Expansion Management Revue, Septembre 2000
[11] Source Le Figaro du 13 août 2006