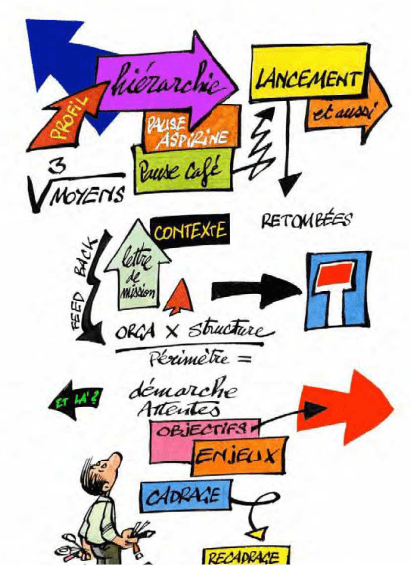À un moment de l’histoire où nombreux sont ceux qui s’interrogent sur le bien fondé de la réduction du temps de travail, Le Syndrome de Chronos montre les ravages d’un conflit qui oppose le temps des hommes et le temps des machines, et pose un diagnostic critique sur notre consommation du temps. Les auteurs analysent de façon précise les déséquilibres engendrés par les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) : zapping mental, déstructuration des espaces de travail, pression du temps réel, sollicitations permanentes, confusion entre temps privé et temps professionnel, etc. Ces phénomènes amplifient les perturbations du monde du travail, déjà désemparé par la pression productiviste et les restructurations permanentes. Les nouveaux temps modernes sont à l’origine d’une médicalisation croissante de la vie active, conséquence du stress et des « télénévroses ». Un mal travailler et un mal vivre qui coûtent très cher à la collectivité et aux entreprises. Fondé sur trois ans de recherches documentaires et d’entretiens, cet ouvrage propose des recommandations aux pouvoirs publics et aux entreprises pour faire face au syndrome de Chronos : réduction de l’intensité du travail contre l’allongement de la vie active, rénovation du rôle de la médecine du travail, et politique des revenus adaptée à la mutation actuelle de l’économie du travail et du capital. En définitive, Le Syndrome de Chronos plaide pour une écologie du temps, un temps qui, selon les auteurs, n’a pas de prix… comme la vie.
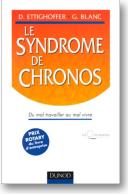 Voici un extrait du livre écrit dans les années 90: le chapitre sur les « Temps Modernes »
Voici un extrait du livre écrit dans les années 90: le chapitre sur les « Temps Modernes »
« Dominés par le “présentéisme“, nous vivons dans l’empire de la nanoseconde, le culte du jetable, la célébration de l’éphémère, la programmation optimisée de l’obsolescence, l’esthétique de l’instant, l’obsession des délais-zéro, l’étourdissement des clips télévisuels fugaces, l’idéologie de l’urgence frénétique. » [1] Confrontés à une déstructuration de leur espace de travail facilitée par la généralisation des « infotechnos », les hommes doivent désormais faire face à la déstructuration de leur temps. Cette fin de siècle est marquée par d’immenses progrès techniques qui ont fait de la vitesse une donnée incontournable de nos économies et de nos modes de vie. Les progrès de l’augmentation des performances des transports physiques n’étaient rien face aux performances atteintes par les échanges électroniques d’informations. Les artefacts des temps modernes ont progressivement atteint et modelé notre culture. Nous n’allons pas vite, nous vivons vite !
Temps de vie, temps de travail, temps des loisirs, les pays ont vis à vis du temps mais aussi de l’espace des attitudes culturelles bien particulières. Une peuplade d’Amazonie fait de son refus du temps un facteur de sa sauvegarde. Le présent, le passé, le futur n’existent tout simplement pas. Les hommes se comportent différemment face au temps. Au point que les temps modernes, qui se caractérisent par une modification des rythmes de vie et de travail, constituent une véritable souffrance pour certains, une euphorie particulière pour d’autres. En d’autres termes, ce n’est pas uniquement la durée du temps de travail qui crée la fatigue mentale et nerveuse des travailleurs modernes, mais ce sont les rythmes imposés. Ce qui nous oblige à revoir l’idée que nous nous faisons, non seulement de l’organisation des temps de travail, mais aussi des rythmes de travail particuliers. Avec pour conséquence que nous devons revoir non seulement la flexibilité du travail mais aussi celle de l’organisation du repos et des congés.
1 – Si le temps m’était compté
Pour comprendre la « dangerosité » des nouveaux temps de travail modernes, nous devons commencer par examiner les attitudes face au temps selon les pays, les cultures, en nous référant en particulier aux travaux de l’anthropologue américain Edward Hall. D’abord culturellement centré autour de la société rupestre, agricole, puis profondément reconditionné et modelé par les rythmes de la société industrielle, un nouveau temps se met en place non sans quelques résistances.
La problématique des pratiques temporelles d’aujourd’hui est qu’elles ne se centrent plus uniquement autour de la durée du travail, de sa répartition au cours de la journée, de la semaine. Le « temps moderne » est caractérisé par un fait nouveau qui est à la fois l’accélération des rythmes de travail et la déstructuration d’un temps surencombré. Le temps actuel, moderne, est « unique, rythmé et encombré » déclare Jean-Louis Servan-Schreiber au début de son livre L’art du temps [2]. Cette phrase ne peut résumer toutes les caractéristiques et la diversité des perceptions du temps. Le temps est si étroitement mêlé à la trame de l’existence que nous n’avons qu’une conscience partielle de la manière dont il détermine le comportement des individus et modèle les relations interindividuelles. Les rapports au passé, au présent et à l’avenir diffèrent selon les tempéraments et les cultures. Certes, comme le dit Jean-Louis Servan-Schreiber, « en général, le passé l’emporte sur le futur, ne serait-ce que parce qu’il faut moins d’efforts pour se souvenir que pour prévoir ». Mais de plus, l’accélération des rythmes de vie mobilise et concentre les hommes sur le présent. Il règne actuellement un certain malaise face au temps, pour Bernard Ibal, vice-président confédéral de la CFTC et aussi docteur d’État en philosophie : « Nous n’avons plus de passé : la vie moderne nous dépossède de nous-mêmes, nous déracine et nous déporte au gré de la mobilité professionnelle, des recyclages, de la fuite en avant et des divorces en toute genre. Nous n’avons plus d’avenir : les jeunes, sans horizon clair, perdent la boussole, et les “vieux”, menacés dans leur retraite, ne sont pas pressés de faire place. Le temps se contracte sur un présent sans repère ni ouverture »[3].
Nous avons des rapports ambigus et opportunistes avec le passé mais plus encore avec un présent plus ou moins dense : « vivre comme si demain nous étions morts » entache l’idée même que nous nous faisons de l’avenir où s’affrontent les partisans d’une logique économique du long terme et ceux du court terme.
Des rapports ambigus et opportunistes avec le passé
L’historien Jean Chesneaux nous rappelle que coexistent souvent différentes conceptions du passé au sein de la société française : « Tantôt le passé sert de repoussoir, pour mieux célébrer nos performances technologiques. Tantôt il se dégrade en matériau culturel de large consommation marchande. Tantôt encore il est promu à la dignité de « patrimoine », en vue d’injecter un supplément d’âme à une époque qui en semble plutôt démunie » [4]. Cette attitude nous empêche de nous situer dans le temps sous son double aspect, continu, qui assure la transmission des traditions du passé, et discontinu, qui marque les grandes transformations de la société. Un autre aspect ambigu selon les cultures tient à la notion de « passé lointain ». Les Américains ont tendance à considérer les événements datant d’il y a une vingtaine d’années comme de « l’histoire ancienne ». Chez eux, comme le note l’anthropologue Edward Hall, « le passé collectif s’estompe en s’éloignant » ; au contraire, « dans les cultures qui s’attachent à garder leur passé en vie on considère que le monde quotidien prend son sens à partir du passé. » [5]
Autrefois, les traditions orales et gestuelles servaient de médiateurs à la passation des expériences et des savoirs. Les outils passaient de génération en génération. Il fallait être économe. Nombre d’ateliers gardaient la mémoire des plans, des maquettes, des chefs-d’œuvre des meilleurs compagnons. Chaque arpète savait la somme de peines et d’ingéniosités que représentait un travail donné. Aujourd’hui, le turnover, les plans sociaux, les fusions, les délocalisations ont laissé en route toutes ces émotions, ces joies du bel ouvrage, ces peines partagées. Dans les entreprises modernes, qui se soucient comme d’une guigne du passé, sinon pour parler de temps à autre « du bon vieux temps », cette notion du temps passé va être modifié, perturbé par un terme contemporain propre à la société de l’impatience : les délais. Le passé se compte en jours voire en heures. Les flux tendus et le temps réel imposé par les « infotechnos » écrasent toute perspective historique. La mémoire de l’entreprise est utilitaire, elle est contenue dans les mémoires de ses ordinateurs. Le plan comptable offre la perspective vertigineuse de l’année écoulée ou de celle à venir (sic). Aussi, alors que l’on ne cesse de chercher du « sens » dans les entreprises, comment s’étonner de constater que le quotidien perd tout son sens puisque le passé n’en a plus. Comment s’étonner aussi de constater combien toute évolution stratégique majeure est devenue très difficile dans les compagnies contemporaines. Son corps social a perdu les bases fondatrices à partir desquelles se bâtit toute perspective d’évolution.
Nous ne savons même plus jouir de ce que le progrès nous a apporté parce que nous ne savons même plus ce qu’était… hier ! Et nous ne savons pas nous en protéger, lorsque c’est nécessaire, puisque nous ne savons plus pourquoi nous l’avons inventé. Les mutations des sociétés sont dues à celles des technologies et à l’inventivité prodigieuse des hommes. Ne pas savoir pourquoi les technologies ont été inventées c’est ignorer pourquoi et comment les sociétés ont évolué. Ne pas savoir pourquoi et comment les sociétés ont évolué c’est se priver de la compréhension du présent, une denrée rare.
Dans les années trente, la révolution industrielle a permis à la classe ouvrière d’obtenir les congés et le repos dominical, d’épargner des organismes physiques que la production automatisée du travail mettait à mal. Pourquoi, alors que nous devrions jouir de ces avancées techniques, alors que les pointeuses disparaissent des entreprises et les ouvriers des chaînes des usines, pourquoi, jamais notre rapport au temps n’a été aussi contraignant ?
Le présent est une denrée rare (Il est sur-encombré)
Plusieurs facteurs déterminent l’attitude face au présent : sa rareté et le sentiment de sa « vitesse » d’écoulement, sa durée relative et sa profondeur, le fait de faire ou non plusieurs choses en même temps. Le temps s’avérait en 1981 arriver en tête des facteurs de contrariété des français actifs. La Cofremca les avait interrogés cette année-là sur leurs principaux centres de frustration. Le temps arrivait en tête avec 43% ; l’argent, ne venait que loin derrière avec 27% [6]. Les gens semblent manquer de temps, Jean-Louis Servan-Schreiber soulignait le paradoxe qui fait que « rares sont ceux qui estiment en avoir suffisamment, alors que chacun dispose de sa totalité » [7]. A notre époque, il semble que tout le monde se plaigne du manque de temps au point que ce soit devenu une banalité de l’exprimer. Bruno Jarrosson commente cette attitude en se demandant si «se plaindre de manquer de temps est digne d’un esprit correctement structuré » et ne revient pas à « passer à côté du temps ». [8]
Edward Hall a étudié comment les Américains perçoivent la durée relative, qu’ils déterminent par quatre moyens : 1) le degré d’urgence ; 2) le fait de faire ou non plusieurs choses à la fois ; 3) le fait d’être occupé ou non ; 4) le degré de variété qui entre en jeu dans la situation [9]. Il ne semble pas qu’une telle étude ait été réalisée en France. La manière dont le présent est ressenti, le sentiment qu’il s’écoule plus ou moins vite sont très liés non seulement à celui de la rareté, mais aussi à l’importance que nous donnons au passé. Plus le passé est oublié, plus le présent semble passer vite. Alvin Tofler, dans le « Choc du futur » s’attachera à montrer que cette sensation d’écrasement du temps est liée à la réduction de la durée des actes les plus courants. Ce qui donnera lieu à toute une série de services rapides et de produits qu’il qualifiera d’éphémères. Dans une grande ville, les habitants rencontrent aujourd’hui plus de personnes en une journée que nos arrières grands parents dans toute leur vie. Phénomène comparable dans les entreprises, où les rapports entre les hommes seront plus fréquents mais aussi plus éphémères et moins impliquants. Précurseur, il annonce, dans les années 1970, que nos rapports avec les choses, avec les lieux, avec les personnes vont être progressivement transformés. Ils seront plus courts, plus fréquents, plus superficiels. Parfois plus étroits et plus agressifs aurait-il pu ajouter. En fait, on ne peut dissocier une réflexion sur les temps modernes sans y incorporer une donnée nouvelle qui est celle de leurs rythmes. Le « zapping » frénétique des individus dans leurs activités a remplacé les cadences infernales : il explique en partie le mal vivre vite !
L’organisation du présent : monochronie ou polychronie ?
Les sollicitations se multiplient, les gens se dispersent. Cette sensation de vivre vite agit sur la psyché collective. Elle varie en fonction des cultures. Etudiant l’attitude des sociétés complexes face à « l’épaisseur » du présent, Edward Hall a observé qu’elles organisent le temps d’au moins deux manières différentes : les éléments sont organisés en tant qu’unités séparées, une chose à la fois ou, au contraire, les individus sont engagés dans plusieurs événements, situations ou relations à la fois [10] . Ces deux systèmes d’organisation sont logiquement et empiriquement tout à fait distincts. Il a appelé polychrone le système qui consiste à faire plusieurs choses à la fois, et monochrone celui qui consiste, au contraire, à ne faire qu’une chose à la fois. Les Européens du Nord et les anglo-saxons, organisés et ponctuels, sont des monochrones qui perçoivent le temps dans sa globalité et ne supportent pas d’être perturbés. Ils préfèrent la tranquillité d’esprit à l’agitation. Les Latins, plus brouillons mais improvisateurs, sont des polychrones qui vivent le temps comme une succession d’événements et privilégient le fait du moment. Chaque conception a ses avantages et ses inconvénients.
L’organisation monochrone sert de système de classification pour créer de l’ordre dans la vie. Les structures temporelles, profondément intégrées et ancrées dans la culture, nécessitent un apprentissage de la part des individus. Elles semblent représenter le seul moyen naturel et logique d’organiser toute activité. Pourtant elles ne correspondent pas toujours aux rythmes biologiques de l’être humain, on ne peut pas dire qu’elles font partie de sa nature. La vie professionnelle, sociale et même personnelle d’un individu est généralement dominée par un horaire ou un programme qui permet de se concentrer sur une chose à la fois, pour passer à une autre ensuite. Mais cette organisation du temps se traduit aussi par un appauvrissement du contexte. Son caractère compartimenté rend les individus moins enclins à considérer leurs activités comme liées à d’autres, comme parties d’un tout : le travail lui-même, ou même les buts de l’organisation du travail, sont rarement perçus comme un tout. Dans un système monochrone, le temps est aussi considéré comme une réalité tangible. On le dit gagné, passé, gaspillé, perdu, inventé, long, ou encore on le tue, où il passe. Edward Hall avertit qu’il « faut prendre ces métaphores au sérieux ».
Dans un système polychrone, le temps est traité de façon moins concrète. L’accent est mis sur l’engagement des individus et la réalisation des contrats plutôt que sur l’adhésion à un horaire préétabli. Souvent les rendez-vous ne sont pas pris au sérieux, et donc parfois négligés ou annulés. Par contre, les membres des cultures polychrones accordent une importance particulière aux relations interindividuelles. L’observation des réactions de ses compatriotes Américains, monochrones par excellence, aux cultures polychrones, en particulier en Amérique du Sud, conduisit Edward Hall à constater combien cette attitude face au temps « influence le mode de circulation de l’information, la texture des réseaux qui lient les individus les uns aux autres, et de nombreuses autres importantes caractéristiques sociales et culturelles d’une société ».
En fait, rares sont les individus qui sont uniquement monochrones ou uniquement polychrones. Ce qui compte c’est surtout la culture dans laquelle ils vivent et travaillent. Edward Hall apporte quelques commentaires sur l’influence de ces perceptions du temps sur le travail. « La rapidité avec laquelle on peut analyser une profession est limitée ; mais une fois cette analyse effectuée, une application appropriée des résultats obtenus permet à un directeur polychrone de diriger un nombre surprenant d’employés. Néanmoins, les organisations gérées selon le modèle polychrone sont de taille restreinte ; elles doivent aussi être dirigées au sommet par des individus capables et elles réagissent lentement et difficilement à tout élément nouveau ou différent. Sans personnes compétentes, un système administratif de type polychrone est un désastre. Les organisations de type monochrone, au contraire, se développent beaucoup plus que les précédentes, et elles combinent les bureaucraties au lieu de les multiplier ».
Temps réel : l’état d’urgence permanent
Le terme de “temps réel“ vient de la technique informatique. Il désignait initialement le fonctionnement d’un système dans lequel les différentes tâches sont traitées immédiatement au fur et à mesure de leur apparition. L’expression a été utilisée dans la gestion pour désigner les systèmes transactionnels en ligne ou dans le monde industriel, par exemple dans le contrôle de procédés. On parle fréquemment de “saisie en temps réel“ pour désigner l’enregistrement de données au fur et à mesure qu’elles sont émises, par exemple pour la constitution de fichiers d’informations personnelles par entretien téléphonique. Cette tâche répétitive nécessite de maîtriser dans l’instant les variables qu’avait envisagées le programmateur qui a préparé le logiciel. Tout événement nouveau risque de prendre de court l’opérateur.
Depuis 1988 Yves Lasfargue a beaucoup insisté sur les risques que courent certaines personnes face à l’obligation de réagir en temps contraint face à un écran qui parfois les paralyse. Nombre de dispositifs automatiques, comme les distributeurs automatiques de billets de banque ou de tickets de chemin de fer, ne laissent guère de temps pour hésiter si l’on ne sait pas bien s’en servir. Selon lui, l’interactivité, qui rejoint les jeux vidéo, constitue une source de plaisir pour une bonne moitié des ouvriers, mais un quart de la population active en souffre. « Être capable ou non de répondre à l’ordinateur en temps imposé et s’adapter à l’abstraction de la représentation sur écran n’est lié ni à un certain degré de capacités intellectuelles ni à un certain niveau d’études. Le jeune brouillé avec les études peut s’y trouver parfaitement à l’aise et un universitaire peut ne pas y parvenir » [11]. Cette informatique s’avère fort différente de celle que l’on utilise à son propre rythme sans aucune contrainte de temps. Yves Lasfargue reconnaissait qu’il ne savait guère remédier à cette difficulté de l’interactivité dans les formations organisées par l’organisme qu’il dirige, le CREFAC.
Cette notion de temps réel s’est étendue petit à petit à tous les domaines d’activité et l’expression “vivre en temps réel“ semble être devenue une caractéristique de notre époque. Nous vivons sous la tyrannie de la vitesse absolue. Comme l’exprime Bruno Jarrosson l’urgence et le manque de temps sont devenus des pathologies de notre époque. « Le zapping universel, forme moderne de la rapidité, n’empêche pas chacun de manquer de temps. L’urgence est cette maladie qui se prend pour sa propre thérapie. […] Plus je gère mon temps comme une ressource rare, plus rare est la ressource. L’urgence engendre l’urgence » [12].
L’urgence et l’encombrement de son temps ont pris des valeurs symboliques. Michel Crozier soulignait déjà en 1969 que « tous les Français qui accèdent à des responsabilités sont suroccupés, et ceux qui veulent accéder ou veulent avoir l’air d’y être parvenus le sont encore plus… Dans un tel cercle vicieux, l’encombrement devient une drogue et un signe même de la supériorité de ceux qui sont in » [13]. L’encombrement du temps a des fonctions de signe. Jean-Pierre Dupuy et Jean Robert remarquaient en 1976 que « le mode de vie fiévreux, qui est celui de la classe dominante, devient une référence par rapport à laquelle on se situe » et ils mentionnaient le mot d’Alain sur l’inanité de la vitesse « les gens qui gagnent un quart d’heure en allant à Paris et Deauville à fond de train utilisent ce quart d’heure à se vanter de l’avoir fait » [14]. Bruno Jarrosson insiste sur l’image sociale donnée par l’urgence. « Le degré d’urgence auquel nous sommes soumis concrétise le flux d’informations qui nous arrive et donc notre importance. Il y a un snobisme de l’urgence et du manque de temps. Quelle insigne misère de n’avoir pas une minute à soi quand la minute présente est la seule façon de posséder la vie ! A la pointe du snobisme de l’urgence, l’importance d’une personne ne se mesure pas à ce qu’elle fait, mais ce qu’elle n’a pas le temps de faire. […] Le manque de temps a toujours été le propre de l’homme d’action. Car l’homme d’action veut toujours tricher, éviter de donner du temps »
Dans les grands groupes comme dans les PME, l’urgence est devenue un mode de gestion quotidienne. Nombre d’entreprises fonctionnent dans l’état d’urgence permanent qu’elles justifient par le contexte hyperconcurrentiel auquel elles sont confrontées. Elles expliquent à leurs employés qu’il faut payer un prix pour rester compétitif : réagir immédiatement, parer au plus pressé en permanence, valoriser au plus haut point l’action immédiate et travailler au-delà de l’horaire légal sans demander de compensation financière.
Les pratiques des Etats-Unis ont sans doute joué un rôle, car la société américaine attribue une valeur très élevée à la rapidité. Comme l’explique Edward Hall, « un homme lent est souvent accusé d’impolitesse ou d’irresponsabilité. Certains, portés sur la psychologie, diront que nous sommes obsédés par le temps. Ils trouveront dans la société américaine, des individus qui sont littéralement aliénés par le temps» [15]. Dans cette ligne de conduite, l’entreprise tend à privilégier l’immédiat, à porter aux nues la performance d’un jour pour l’oublier le lendemain. Elle organise l’amnésie et oublie son passé.
Cet activisme possède plusieurs facettes. Certains, qui tombent dans une impatience chronique, voudraient que tout moment soit productif. D’autres l’utilisent pour prendre le temps de faire autres choses que les tâches urgentes, pour s’informer, se former, réfléchir, se mettre en mesure de faire face aux aléas, aux événements imprévus qui ponctuent la vie d’une usine ou d’un bureau et trouver ce qu’ils apportent de positif et d’inattendu. On trouve aussi des personnes pour lesquelles le travail dans l’urgence constitue une forme de dopage. Comme le dit Françoise Reyès, responsable des séminaires sur la gestion du temps à la Cegos, en parlant de ses clients « pour certains, courir tout le temps est une forme de dopage. Ils ont besoin de faire monter leur taux d’adrénaline pour se stimuler » [16].
Beaucoup de gens confondent vitesse et efficacité. L’entreprise ne se soucie pas de vitesse, mais d’efficacité. Les gens efficaces ne sont pas pressés, ils ont une minute à eux. Comme le soulignait Pierre Drouin, « même si l’entreprise doit être en mouvement perpétuel, le pouls des dirigeants ne doit pas battre trop vite » [17]. Les gens pressés devraient méditer cette phrase de l’écrivain Sten Nadolny, auteur d’une biographie romancée de l’explorateur anglais John Franklin, homme extrêmement lent qui a su transformer son infirmité en avantage : « Ce Franklin est si lent qu’il ne perd jamais de temps » [18].
 Le futur a-t-il un avenir ?
Le futur a-t-il un avenir ?
Dans un tel contexte d’urgence permanente, de surestimation du temps présent, cette question n’est pas une boutade. Le débat entre le court terme et le long terme agite les économistes depuis plus de soixante ans. Entre Keynes qui disait « à long terme, nous serons tous morts » et les protecteurs de l’environnement qui souhaitent que les calculs économiques prennent en compte les besoins des générations encore à naître, il est difficile de trouver un terme satisfaisant. L’impression générale qui se dégage des comportements économiques ou politiques actuels valorise le profit le plus immédiat possible quel qu’en soit le prix collectif à terme. L’accélération des échanges due au temps des ordinateurs a laissé sur place une civilisation qui se grisait de vitesse. Avec « le temps réel », elle a rendu le court terme encore plus proche et important. En même temps les incertitudes sur l’avenir donnent l’impression que le long terme est insaisissable…ou qu’il a moins d’importance !
Les entreprises allemandes et japonaises sont plus habituées à penser au long terme que leurs homologues britanniques ou américaines dont l’horizon se situe souvent au prochain résultat trimestriel. Si l’entreprise paraît préoccupée par le court terme, les individus, pour leur histoire personnelle, accordent plus d’importance à la longue durée.
Edward Hall compare l’attitude des Américains, tournés vers le futur, qui aiment la nouveauté et le changement et qui planifient volontiers leur avenir, à celle des Hindous pour qui le futur proche recouvre plusieurs générations. « Pour nous, “longtemps”, c’est tout et rien – 10 ans ou 20 ans, 2 ou 3 mois, quelques semaines ou même quelques jours. Par contre, l’Asiatique considère que des milliers d’années, ou même une période illimitée, définissent parfaitement bien le concept « longtemps » [19]. Ces observations nous obligent à donner une toute autre interprétation aux logiques économiques dominantes. Les analyses fondées sur la comparaison des cycles économiques, étudiés dans le livre de Michel Albert, différencient l’économie rhénane (qui privilégie avec l’économie asiatique, le long terme) de celle anglo-saxonne (qui donne la prééminence au rendement financier à court et moyen terme). Selon cette interprétation du temps, ces logiques reflètent plus des différences culturelles qu’une logique économique éclairée, ou non. Elles révèlent le comportement collectif du peuple qui les a construites. Elles sont historiquement génétiques.
Ces différences de perception du futur peuvent expliquer que les chefs d’entreprises ou les responsables politiques de certaines nations préfèrent prendre des mesures à court terme, visibles, moins désagréables. Elles forment un écran de fumée soit pour cacher leur impuissance à anticiper, soit pour éviter de prendre des décisions importantes à long terme pour la collectivité, mais désagréables sur le moment. Peu d’entre-eux s’avisent que c’est la conciliation entre le passé, le présent et le futur qui construit le contrat social. Alors que de plus en plus d’individus se défendent de n’être que des outils de « Produit National Brut », l’écrasement du court terme empêche de donner du sens au futur, sinon celui d’une courbe de production de richesses. Ce que de plus en plus de sociétés et d’individus refusent. Observation essentielle lorsqu’il s’agira de remettre en question un modèle de la gestion du temps de travail traditionnel trop étroitement corrélé avec l’économie. De même que le fonctionnement d’une organisation quelconque dans une entreprise ne nécessite pas la présence permanente de la totalité de son personnel, de même dans les nations avancées, la croissance de richesses est de plus en plus déconnectée de la durée réelle du travail. Les revenus, non.
Si chaque individu doit être le héros de sa propre histoire, comme le raconte Paolo Coelho, dans « l’Alchimiste », pourquoi ne pas imaginer que l’entreprise soit l’héroïne d’une histoire qui serait écrite par ses dirigeants ?! Ce serait une solution concrète pour réconcilier les générations qui cohabitent dans l’entreprise. Pour avoir occulté les émotions, le sens du temps, donc le sens tout court nous consommons de façon frénétique et anarchique un temps qui reste rare… et cher !
2 – Le temps des chronophages
La société industrielle a suscité jusqu’il y a peu de temps une organisation quasi militaire du monde du travail. Des horaires rigides étaient imposés à tous, car il importait de synchroniser les activités. Le temps de travail joue un rôle économique mais aussi social considérable. C’est un facteur économique sur lequel les entreprises peuvent jouer pour ajuster sa durée totale, son organisation et sa répartition en fonction de la demande et des moyens techniques. C’est un facteur social, il constitue pour les salariés, non seulement un sujet de négociations relatives aux salaires et aux conditions de travail, mais aussi un élément structurant de leur vie personnelle et de leur vie sociale. Rien d’étonnant si dans le sondage de l’Observatoire du monde du travail, 28% des 16-24 ans interrogés sur leurs principales préoccupations professionnelles mettent en avant en premier le temps consacré à leur travail. [20]
Les chiffres officiels indiquent une tendance lourde à la baisse du temps de travail sur le long terme. Le passage aux 39 heures — une baisse de 2,5% — n’a pas entraîné de baisse de la production, car les gains de productivité ont absorbé la diminution du temps de travail des hommes. C’est la durée d’utilisation des machines qui s’est adaptée aux cycles économiques. Mais a-t-on vraiment diminué le temps de travail ? Ces moyennes ne dupent que ceux qui le veulent bien. Les entreprises avec la complicité de leur encadrement ont grignoté, et au-delà, les baisses de temps de travail gagnées durant les années 60. Dans ce domaine comme dans d’autres, il existe des inégalités flagrantes. Il suffit d’écouter les français pour s’en convaincre.
La norme du « temps de travail » n’a plus aucune signification
L’observation et l’analyse des comportements de professionnels non informaticiens d’un groupe de discussion professionnel sur Internet illustre bien le rôle des « infotechnos » sur le temporel. Un forum de discussion sur le droit, fr.misc.droit, a été créé en juillet 1995 à l’initiative de Jérôme Rabenou, ancien informaticien et étudiant en deuxième cycle de droit, animateur de longue date de réseaux professionnels, notamment Calvacom. L’étude statistique de l’activité de ce groupe de discussion et du courrier électronique suscité par ces échanges recouvre, au total, près de 7000 contributions aux discussions et près de 1300 messages échangés. La répartition du courrier électronique au cours de la journée montre deux pics, le premier le matin entre 9h et 12h, le second, l’après-midi entre 17 et 19h, chacun dépasse 7% du total quotidien. De 7h du soir à minuit, chaque heure reste supérieure à 3% du total quotidien, alors que de minuit à 7h du matin aucune tranche horaire ne représente plus de 2% du total quotidien. Plus des 2/3 des utilisateurs envoient leur courrier électronique entre 8h et 19h, c’est-à-dire pendant les heures ouvrables.
Des analyses plus fines, individualisées dans la mesure du respect de la vie privée, montrent qu’il existe des comportements types. Un peu plus de 10% des personnes présentent une déstructuration totale de leur temps et n’ont aucune régularité dans leur activité d’envoi de courrier électronique. La répartition hebdomadaire marque une nette évolution entre le premier et le second semestre 1996. L’écriture du week-end est devenue presque identique à celle des lundi et mardi, alors qu’auparavant, elle diminuait nettement. La plupart des utilisateurs sont passés, avec l’accroissement de l’utilisation des services électroniques interactifs, d’une semaine structurée selon les heures ouvrables à une semaine continue, sans pause.
Que pense l’ensemble des français de leur temps de travail ? Dans un sondage de l’IFOP pour Libération, en novembre 1993, un tiers des personnes interrogées (34%) trouvaient que leur temps de travail était beaucoup trop ou un peu trop important, sans grande différence entre les hommes et les femmes (33% et 35% respectivement). C’étaient les deux tranches extrêmes de revenus qui portaient un tel jugement : 40% chez les foyers ayant moins de 5000 F de revenu mensuel, et 43% des foyers ayant plus de 20000 F par mois. On ne peut dire plus clairement que ce sont plutôt aux salariés les plus démunis et aux cadres que l’on impose des horaires anormaux. Alors que la durée légale du travail a été fixée à 39 heures en France aujourd’hui, 40% seulement des entreprises respectent ce seuil ; 40% sont au-delà par le biais des heures supplémentaires et 20% en deçà, soit par une volonté délibérée, soit à cause d’un recours massif au chômage partiel. [21]
Nombre de salariés se plaignent de la surcharge de travail qu’entraînent les nouvelles pratiques des entreprises. Les directions ont augmenté leurs exigences. Beaucoup considèrent comme normal d’imposer aux salariés de passer un temps d’une longueur peu naturelle à leur bureau, et ce, quels qu’en soient les effets. Le temps de présence reste encore une obsession de nombre de chefs d’entreprise qui pensent que le rendement d’un salarié dépend des heures qu’il passe à son bureau sous leur œil vigilant. Dans la plupart des travaux de bureau, le résultat – en fait, ce que l’entreprise vend à ses clients – ne dépend plus du temps de présence.
Reste que toute réflexion sur la réduction du temps de travail ne peut ignorer que parmi les motifs d’insatisfaction liés au temps de travail figurent en bonne place la crainte de perdre le surcroît de salaire gagné grâce aux heures supplémentaires. C’est un facteur de blocage des discussions avec les salariés qui, disposant de faibles revenus, continuent à vouloir faire des heures supplémentaires. D’un autre côté, un grand nombre d’entreprises ont recours aux heures supplémentaires pour pallier les à-coups de production. Ce que dénoncent, 30% des moins de 30 ans et 22% des 30-49 ans [22] interrogés lors du sondage de l’Observatoire du monde du travail. De plus, nombre de ces heures supplémentaires ont un coût social élevé, car elles sont maquillées en primes ou pis encore effectuées au noir, sans paiement des charges sociales. Ce problème n’est pas uniquement français. Aux Etats-Unis, en 1994, chaque salarié de l’industrie a effectué un nombre d’heures supplémentaires impressionnant : 4h42mn par semaine. Nombre de ces heures ne sont pas payées, d’où des gains de productivité du travail apparents mais volatils dès que la conjoncture se réduira.
En fait les entreprises reculent de toutes sortes de façons le seuil à partir duquel elles admettent de payer des heures supplémentaires… ou embaucher. Beaucoup de cadres et assimilés ne doivent leurs statuts (Chronos s’est encore fait avoir par Réa !) qu’à ce petit calcul. La solution viendra sans doute, moins de l’obligation de respecter la durée du travail, ce qui est toujours difficile, que d’augmenter les revenus en proportion non seulement du temps travaillé mais aussi, nous défendrons cette idée plus loin, de la richesse crée.
Tous les actifs sont soumis à la déréglementation de la durée du travail
Continuer à mesurer le travail par sa seule durée est devenu absurde. La présence comme critère d’efficacité reste un mythe que les directions, chronophages, devront abandonner. L’amalgame entre « temps de présence” et efficacité représente un des travers de la culture d’entreprise française les plus violemment dénoncés par les femmes. La promotion professionnelle nécessite de s’attarder au bureau. Le gros travailleur, celui qui reste tard, est généralement bien vu dans l’entreprise, indépendamment de ses résultats. Certains chefs ont l’habitude de faire commencer à 18h30 des réunions qui vont durer jusqu’à 20h30 et permettront de tester les cadres acceptant de partir tard. [23]
Cette hantise des heures de présence privilégie la visibilité plutôt que les résultats. Avec les technologies actuelles, le temps de présence ne rend plus compte de la réalité du travail, mais il reste souvent plus facile à vérifier que la qualité du travail fourni. Que disent les statistiques à ce sujet ? Un foyer français moyen consacre désormais 59 heures de sa semaine au bureau ou à l’atelier, pour 46 dans les années 60 [24]. De source patronale 15% seulement des salariés travailleraient au-delà de 40 heures. Mais quand en 1995, l’INSEE interrogeait 90000 d’entre eux, ils étaient 23% à déclarer plus de 45 heures hebdomadaires [25]. Ce n’est pas qu’en France que cette situation se produit. En Grande-Bretagne, où la situation vis-à-vis du chômage est censée être bien meilleure qu’en France, près d’un salarié sur cinq, soit 4,5 millions de personnes travaillent aujourd’hui 48 heures ou plus par semaine [26].
Si on mesure, le temps de travail moyen selon les actifs, toujours, selon le sondage réalisé par l’IFOP pour le compte du quotidien Libération, les Français travaillent en moyenne 42 heures, les hommes un peu plus (45 heures), les femmes un peu moins (37 heures) [27]. Ce sont les artisans et les commerçants qui travaillent le plus longtemps (57 heures), suivis par les agriculteurs (50 heures), les cadres et les professions libérales (46 heures), les ouvriers et professions intermédiaires (40 heures) et enfin les employés (37 heures). Les salariés du secteur public travaillent seulement 38 heures, ceux du secteur privé 41 heures alors que les travailleurs indépendants déclaraient passer 53 heures par semaine à leur travail.
Sur le terrain, c’est souvent l’installation – ou la réinstallation – d’une pointeuse qui conduit les salariés à s’apercevoir qu’ils travaillent beaucoup plus que les 39 heures hebdomadaires légales. Chez Nestlé, le décompte global des horaires a montré que chaque salarié donnait en moyenne une journée de travail gratuite tous les 20 jours à son entreprise [28]. L’installation d’une pointeuse a été vécue comme une libération pour les salariés d’un abattoir de Bourg-en-Bresse qui travaillaient à la chaîne avec des horaires de cadres [29].
Fait nouveau, de plus en plus de cadres vivent leur semaine de plus de 45 heures comme une aberration économique et comme une injustice. Ils n’acceptent plus de travailler autant. En 1996, les ingénieurs de Matra-Marconi Space se sont mis à compter pour la première fois : 45 heures de travail hebdomadaire en moyenne pour la plupart d’entre eux, plus de 50 pour certains. A leur demande, un inspecteur du travail a été appelé pour venir contrôler les horaires. « Travailler beaucoup a toujours fait partie de la culture de l’entreprise » a répondu la direction. Quelques semaines plus tard, un sondage commandité par la CGC et mené auprès des 1500 salariés du site venait ébranler cette certitude : 83% se prononçaient en faveur de la semaine de 4 jours. Mieux : 84% se disaient prêts à accepter une réduction de salaire à condition que cela crée des emplois. Enfin, 74% d’entre eux se plaignaient d’une manière générale de la surcharge de travail. Chez Thomson-Brest, 30% des cadres jugent le temps qu’ils passent au bureau inacceptable. Même s’ils ne sont prêts qu’à perdre 5% de salaire, 75% des cadres sont d’accord pour partager le travail, à condition qu’il y ait des embauches [30].
Les cadres français se disent prêts à diminuer leur temps de travail, et leur salaire en proportion, dans la mesure où ces réductions s’accompagnent de l’embauche de nouveaux collaborateurs. Ils suggèrent de commencer par revenir à la durée légale du travail, en limitant les heures supplémentaires qu’ils considèrent cependant comme faisant partie des contraintes de leur fonction. Ils reconnaissent les difficultés que pose la réduction des horaires pour diriger et animer une équipe. Pour les surmonter, il faudra qu’ils modifient leurs méthodes de travail. Mais il faudra surtout que change la culture d’un grand nombre d’entreprises qui attends encore que le cadre reste tard le soir au bureau… si ce dernier accepte. Car autant le dire sans détour, en France comme dans d’autres pays, ce sont les cadres seuls qui sont en mesure d’obtenir une remise à plat d’un système « chronophage » est dangereux pour la santé de chacun. La même chose se produit aux Etats-Unis. D’après une enquête récente, les cadres américains s’insurgent : on leur demande trop, affirment-ils.
Les rythmes « normaux » deviennent atypiques
Peter Johnston, responsable de la programmation et du suivi des programmes à la DG XIII de la Communauté Européenne, soulignait lors d’un discours, en janvier 1995 que, selon le Think tank anglais Demos, seulement 1 travailleur sur 3 au Royaume-Uni travaille aujourd’hui selon le rythme standard de la journée de 9h à 17 h [31]. Un tiers des salariés de la Communauté européenne pratiqueraient déjà des horaires atypiques.
La journaliste Marie-Claude Betbeder a comparé la grève de 1953 qui a duré trois semaines, sans PTT ni métro, à celle de novembre-décembre 1995. La première a conduit à une paralysie quasi générale du pays et à des affrontements entre ceux qui voulaient travailler à tout prix et ceux qui en étaient dissuadés par solidarité avec les grévistes. Au contraire, elle fait remarquer qu’en 1995 « c’est une souplesse d’horaires portée à l’extrême, mais déjà largement répandue et surtout entrée dans les mœurs, qui a permis à l’économie de continuer à vivre en décembre 1995 » [32]. Ceci tient au fait que les horaires de travail considérés comme « atypiques », en dehors du 9h-17h standard, deviennent de plus en plus courant. A ceci s’ajoutent les impératifs de délais que subissent plus du tiers des salariés français. La non-conformité des horaires ne concerne pas seulement leur durée, mais aussi leur emplacement au cours de la journée. Les observateurs et les inspecteurs du travail constatent l’étirement de la journée de travail, en particulier avec l’allongement des heures d’ouverture des commerces et des services aux particuliers. Les amplitudes horaires peuvent aller jusqu’à 16h pour les vendeuses « forces de vente » roulant en voiture d’un magasin à l’autre.
Le développement des pratiques du juste à temps a renforcé les contraintes qui s’exercent sur les travailleurs. En 1987, les salariés français n’étaient que 19% à être soumis à des délais ultracourts -24h ou moins – pour la fabrication, le traitement de dossiers ou de commandes. En 1996, ils sont 38% à répondre à la loi du management, celle du « juste à temps », du « zéro stock », du « zéro défaut » [33]. Nombre de secteurs qui ont adopté le système des flux tendus, comme le BTP ou l’automobile, sollicitent de plus en plus longuement leurs salariés pour livrer la commande en temps en période de pointe. Le « travail en urgence », à cadence accélérée, en vrac, en accordéon, contamine de plus en plus de secteurs pourtant à l’abri de la concurrence étrangère. C’est vrai des caissières de grands magasins, des vacataires des centres de tri, des remplaçants scolaires, aussi bien que dans des PME produisant des services à forte valeur ajoutée. Ce sont 21% des actifs ne disposent déjà plus de 48 heures de repos consécutif. [34]
Sur un registre différent, de plus en plus de personnels sont mobilisés pour conduire des projets sensibles, informatiques, lancement d’un service ou d’un film nouveau. La mort de Brent Hershman qui s’était endormi au volant de sa voiture, en avril 1996, a été l’occasion pour les équipes de tournage des studios hollywoodiens, de dénoncer les cadences infernales imposé par l’obligation de tenir les budgets. Ce respect des délais impose des semaines de quatre-vingts heures et plus. Peut-on condamner, oui. Peut-on empêcher ? Difficile, les victimes sont souvent consentantes, nous y reviendrons.
Peut-on y remédier ? Sans doute. En favorisant des contreparties de flexibilité le repos compensateur qui ne soit pas forcément calculées et payées en heures de travail. Car, autre élément à prendre en compte, le découpage horaire ne reflète plus suffisamment la fatigue nerveuse engendrée par des projets qui impose de façon plus ou moins sournoise des semaines de soixante heures. D’où ce commentaire d’une responsable de laboratoire chez Sanofi à propos de la réduction de 20% de la durée du travail proposée en échange d’une réduction de 12% du salaire : « Je suis censée faire 37 heures par semaine. En pratique, nous travaillons souvent entre 40 et 45h. Ce genre d’accord ne servira pas à grand-chose. Ce qu’il faut, c’est la semaine de 4jours» [35]. La durée de la pause doit compenser en conséquence et être payée !
Le sondage de l’IFOP pour Libération de novembre 1993 montrait une nette préférence des salariés français pour les horaires flexibles : 78% les souhaitaient, les hommes autant que les femmes [36]. Les cadres et les professions libérales approuvaient presque à l’unanimité (93%) les horaires flexibles. Les artisans et commerçants (87%) et les agriculteurs (84%) se situaient aussi largement au-dessus de la moyenne nationale.
A rythmes atypiques, repos atypiques : l’aménagement des temps de travail.
L’organisation du temps de travail se diversifie dans un cadre plus ou moins temporaire, plus ou moins négocié, selon les contextes nationaux, et se traduit par des contrats de travail rénovés. Des aménagements des temps de travail sont réalisés, une réduction continue de la durée du travail s’est produite dans les entreprises. Consultante, madame D, a négocié et obtenu une semaine de quatre jours pour préserver la qualité de sa vie familiale. Concession particulière, le cinquième jour est mobile et s’ajuste en fonction des impératifs des interventions en clientèle. Le taux d’occupation et de facturation s’est amélioré pour le cabinet, la perte de salaire était minime. En cas d’urgence, on s’arrange.
Guy Aznar a étudié pour le CATRAL, l’agence régionale pour l’aménagement du temps, qui dépend du Conseil régional d’Ile-de-France, les innovations en matière de temps de travail dans les entreprises françaises [37]. Il les a classées selon trois critères. Le premier est d’ordre psychologique : la solution a-t-elle été choisie par les salariés ou imposée ? Le second a trait à l’organisation ; deux formes de temps réduit dominent le paysage français : le mi-temps et le 4/5 de temps, c’est-à-dire une réduction d’un jour par semaine. Enfin, le troisième critère, qu’il qualifie d’économique et financier, tient compte des types de soutiens accordés pour l’incitation au temps partiel. L’État peut apporter une aide à l’entreprise ou à ses salariés. En situation de crise, ce sont les salariés qui peuvent soutenir l’entreprise en acceptant une diminution de salaire. En situation normale, c’est l’entreprise qui peut aider volontairement ses salariés. Guy Aznar décrit 132 réalisations sur le terrain qu’il classe en « stratégies défensives » (réduction de salaire avec ou sans réduction de temps de travail, temps partiel « défensif »), « stratégies volontaristes de temps partiel choisi » (temps partiel avec ou sans compensation salariale, temps réduit indemnisé de longue durée : TRILD) et « stratégies liées à une meilleure utilisation des équipements » qui incluent le travail en équipes et l’annualisation. Par exemple, à Sacilor, les cadres pourront opter pour une des trois formules : le temps partiel proprement dit, moins de 80% du temps (temps partiel) ou entre 80 et 100% du temps (temps choisi) ; le compte épargne-temps : « épargner des jours de congés » de manière à « disposer d’une réserve de temps permettant la réalisation de projets personnels » et la préretraite progressive. Près de 10% des effectifs français du groupe, soit près de 3700 personnes, devaient travailler à temps partiel à la fin de l’année.
Plutôt que de réduire brutalement la masse salariale en se délestant d’effectifs, ces différentes formes de négociations montre que, peu à peu, la réduction du temps de travail (RTT) est entrée dans les mœurs sous des formes très variées : congé parental, temps partiel « scolaire », etc. Des formules séduisantes pour ceux qui ne veulent pas tout sacrifier à leur carrière. La loi Robien qui a le mérite de s’appuyer sur une solidarité par le travail, et bien que parfois critiqué pour son coût, a eu le mérite de relancer les négociations entre des partenaires sociaux tétanisés à la simple idée de prendre une initiative quelconque. De grandes entreprises se servent de la réduction du temps de travail pour sauver des emplois. Mais surtout, des PME, de plus en plus nombreuses, l’utilisent pour en créer. Nombre d’observateurs des évolutions économiques françaises la commentent d’une manière très positive. Ainsi, Jean-Yves Boulin déclare « Ce texte va développer une culture de la baisse de la durée du travail. » et Gilbert Cette : « Cette loi aura eu le mérite de déclencher un débat et peut-être au-delà, un choc culturel. Quand les salariés sont habitués à des semaines de travail courtes, qui correspondent à leurs attentes, ils ne reviennent pas en arrière ». Brigitte Raymond, chargée de la politique sociale aux AGF déclare que les nouvelles demandes de réduction du temps de travail « émanent de jeunes, plus diplômés que la moyenne. Leurs motivations sont très variées (la famille, la littérature, le théâtre, le sport…) et ils ne veulent pas avoir à les justifier. » [38]
En mai 1996, le cabinet Stratorg a étudié les effets de l’annualisation du temps de travail. Il a examiné 39 entreprises qui, depuis 1982, ont d’une manière ou d’une autre réduit collectivement leurs horaires en les annualisant. Elles ont créé entre 2500 et 3000 emplois, soit 8% des effectifs concernés. Grâce à cet aménagement, du temps elles affirment « avoir développé un avantage concurrentiel, accédé à de nouveaux marchés » et surtout « dégagé des gains de productivité dans une logique beaucoup plus dynamique et plus positive que les dégraissages habituels ». « Aucun chef d’entreprise ne veut revenir en arrière » commente la responsable de l’emploi dans ce cabinet. [39]
Les rythmes des congés contraints sont aussi anti-économiques que le travail contraint
En matière de congés, les français sont le plus gâtés d’Europe. La durée réelle des congés s’échelonne entre 25 et 34 jours par an pour 80% des salariés. Les entreprises paient par le manque d’effectifs, par le dépassement des horaires où par une dégradation de la qualité de ses équipes, faute de pouvoir négocier l’étalement de vacances, que certains français paient de leur santé faute de savoir se reposer. Les congés deviennent souvent un enjeu dans les entreprises. Plus ils s’allongent, plus les directions s’estiment en droit d’accentuer la pression sur les salariés tout au long de l’année. Le choix des dates de chaque salarié donne parfois lieu à des discussions à n’en plus finir, car il faut tenir compte d’un très grand nombre de contraintes. Pierre Vial, secrétaire général adjoint de l’UCC-CFDT constate que «si, dans les PME, les cadres ont parfois du mal à partir, les salariés des grandes entreprises sont moins enclins à faire des cadeaux et prennent, bon an mal an, la totalité de leurs congés » [40]. Les plus audacieux ont expérimentés de nombreuses formules d’aménagement du temps des congés, cela s’avère en général bénéfique pour la qualité du travail et donc pour l’entreprise.
Cette transformation fondamentale s’exprime dans la manière dont les Français prennent des vacances : le fractionnement, c’est-à-dire plus souvent et moins longtemps chaque fois, en moyenne 2,5 départs par personne et par an. Environ 64% des Français partent au moins 1 fois par an en vacances, ce taux progresse légèrement chaque année. Plus d’un tiers des Français, surtout dans les catégories les plus aisées, partent pour des séjours inférieurs à une semaine afin de multiplier les moments de détente au cours de l’année [41]. Cette tendance n’est pas sans lien avec l’évolution des rythmes de travail. Pour le psychiatre Éric Albert, consultant en entreprise, « les gens fractionnent leurs vacances parce qu’ils ne peuvent plus tenir toute une année sans soupape. Le besoin quasi fantasmatique de vacances pour décompresser après une période de tension croissante est un miroir de notre rythme de vie » [42].
Comme le montre le tableau ci-dessous, les salariés français sont les plus gâtés d’Europe. Mais ils restent dans le peloton des traînards en matière d’étalement, ce qui nuit profondément à la productivité des entreprises, à la rentabilité des équipements immobilisés. Les français accepteraient-ils une réduction de la durée hebdomadaire de travail en échange d’un étalement différent de leurs congés annuels ?
Durée des vacances dans 6 pays européens [43]
| Pays | Jours fériés | Vacances légales | Des vacances selon les conventions collectives moyenne annuelle |
| France | 11 | 5 semaines | 5,5 semaines |
| Allemagne | 11 à 14 | 18 j ouvrables | 31 j de calendrier |
| Royaume-Uni | 8 | Pas de dispositions légales | 5 semaines |
| Italie | 4 à 15 | Pas de dispositions légales | 22,7 j ouvrables |
| Pays-Bas | 6 | 4 semaines | 4,5 semaines |
| Belgique | 10 | 24 j ouvrables | 5 semaines |
Aux États-Unis, les congés payés n’existent pas dans la loi. Les entreprises ne ferment pas. Les salariés partent en général plusieurs fois dans l’année, souvent pour une semaine. Seuls 35% de ces départs ont lieu pendant l’été. Au Japon, en 1970, on observait la quasi-absence des congés payés. Moins de 10% des entreprises accordaient à leurs salariés des congés payés supérieurs à 5 jours. On a pu estimer qu’en 1969, cette absence de congés payés diminuait de 8% les coûts de la main-d’œuvre et permettait une production nationale de 8% supérieure. De nos jours, les congés prévus par les conventions sont en moyenne de 15 jours par an. Mais, selon le ministère du travail japonais, un gros tiers des salariés ne prennent pratiquement aucun des congés auxquels ils ont droit (à l’exception des jours fériés), et un autre tiers n’en prennent pas plus de 50%.
- Cadres : une conception fallacieuse du temps
Lorsque l’on veut parler d’un grand patron, du modèle auquel tentera de se conformer le reste de l’entreprise, on dira souvent de lui « qu’il est un bourreau de travail ». Napoléon Bonaparte, organisateur de génie, était réputé ne dormir que quatre à cinq heures par tour d’horloge. Les grands hommes sont par essence débordé, infatigable, et d’une capacité de résistance nerveuse et mentale qui force l’admiration de tous. Ce traitement de façade serait drolatique lorsque l’on a la chance d’entrer dans l’intimité de ces hommes, si cela n’entraînait une cohorte de comportements stupides de la part de zélateurs de tous ordres.
Certains cadres français se glorifient souvent de travailler 50, 60 ou 70 heures par semaine, estimant que leur « niveau de rémunération implique le dépassement de l’horaire légal » [44]. D’ailleurs, lorsqu’ont commencé les discussions sur la réduction du temps de travail, les cadres ont été les plus difficiles à convaincre. « Réduire leur temps de travail, c’est un peu remettre leur travail en question » [45]. La suractivité des cadres se révèle un mal très français. Un fantasme français voudrait que l’on soit un bon manager que si l’on paraît en permanence débordé et stressé. Celui qui gère bien son temps et part tous les soirs à 18h est considéré comme quelqu’un qui ne travaille pas beaucoup. Situation impensable en Allemagne, en Hollande, où les bureaux sont déserts à partir de 17h30.
Le texte très sérieux ci-dessous, sur le temps de travail des cadres date de 1988.
« L’encadrement à tous les niveaux, à commencer par le sommet, doit publiquement renoncer à la moitié au moins des congés auxquels il a droit. Le fait que beaucoup de cadres ne prennent pas la totalité des congés qui leur reviennent n’est pas l’essentiel. Ils doivent être vus au travail pendant des périodes où les congés leur avaient été attribués. Le but recherché n’est pas d’aller vers des normes aussi extrêmes que celles des Japonais ou des Coréens, mais vers la norme intermédiaire des Américains qui considèrent, en général, qu’une quinzaine de jours est un maximum acceptable…Les cadres doivent être vus sur les lieux de travail au moins de 8 à 18 heures ; de plus, les horaires de travail des cadres devraient comporter au moins une demi-journée le samedi. Les arguments à propos du « temps consacré à la famille » ne sont pas valables ; on peut encore lui consacrer un très bon samedi après-midi et le dimanche… La journée de travail de 10 heures devrait avoir, autant que possible, le travail pour objectif et ne pas être interrompue par un déjeuner excessivement long. La norme devrait se situer entre une demi-heure et 45 minutes. » Jean-Pierre Lehman, « Les dix commandements des cadres de l’an 2000 », Notes de conjoncture sociale, n°292, mai 1988.
Depuis une dizaine d’années un nouveau terme est apparu dans la presse et les ouvrages consacrés au travail : le « workaholisme », dérivé du néologisme anglais workaholism, contraction des mots signifiant « travail » et « alcoolisme ». Il s’agit d’une véritable affection, d’une pathologie du travail, comme l’addiction à une drogue. Celui qui ne sait pas s’arrêter de travailler raisonne selon une autre logique que celle de l’accomplissement d’une tâche. Le travail devient sa propre raison d’être, il s’auto-justifie. Il ne se définit pas par sa nécessité ou son utilité mais simplement par son aptitude à remplir le temps. Il est aussi nécessaire au workoolique que la cigarette au fumeur. Le métier de chef d’entreprise ou de cadre supérieur ne nécessite pas d’être workoolique mais c’est là qu’on en rencontre le plus.
Les observations d’Henry Mintzberg donnent un emploi du temps type d’un cadre nord-américain. Il préfère discuter de questions concrètes que de problèmes abstraits. La façon dont il gère son temps suggère aussi l’absence de routine et l’importance du spécifique. Une statistique surprenante se dégage de l’étude des contacts verbaux des directeurs généraux : 1 sur 14 est prévu à l’avance, les autres ne sont pas planifiés. Il n’interrompt pratiquement jamais son rythme d’activité. Chaque minute est occupée, il ne fait pas de pause, le déjeuner et les pauses-café restent utilitaires. Le temps libre est tout de suite happé par des subordonnés.
Pourquoi adoptent-ils ce rythme et cette charge de travail ? Mintzberg pense que c’est d’abord parce que leur tâche n’est pas précisée exactement, qu’ils ne peuvent pas s’arrêter en pensant « maintenant mon travail est terminé ». Il est perpétuellement préoccupé. Il n’est jamais complètement libre d’oublier son travail, il n’a jamais le plaisir de savoir, même un instant, qu’il n’y a rien d’autre qu’il puisse faire. Quelle que soit la nature du travail d’encadrement qui est le sien, il peut toujours penser que ça irait mieux s’il en faisait un petit peu plus.
Pourtant, hormis pour les cadres dirigeants, la durée du travail des cadres relève du droit commun. La cour de cassation du 18 juin 1986 (N° 627 JPS 3/81 n°227) précise que toute convention désavantageuse pour le salarié serait réputée nulle et autoriserait le cadre à réclamer la différence. D’ailleurs, le bulletin de salaire doit faire apparaître clairement l’indication de la durée du travail correspondant au forfait, ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires accomplies au-delà (circulaire du 30 mars 1989). Ce qui suppose que, contrairement à une abstention courante, soit décomptés, sauf convention de forfait claire, les heures de travail supplémentaires comme l’exige l’article L620-2 du code du travail. Voilà qui démontre une fois de plus que notre société dispose de tout l’arsenal nécessaire pour éviter des abus. Faute de volonté, elle ne l’utilise pas en faisant semblant de croire qu’il reste tout à faire. Au plus grand bénéfice de ceux qui vivent de l’ignorance et … de l’idée que les cadres se font d’eux-mêmes !
Une conception fallacieuse d’eux-mêmes
Le cadre doit veiller au bon fonctionnement de l’entité dont on lui a confié la charge, organiser et coordonner le travail de ses subordonnés. Les dirigeants de l’entreprise attendent de lui qu’il fasse des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’unité dont ils lui ont confié la responsabilité, quitte à la modifier ou à la supprimer. Henry Mintzberg a classé les dix rôles du cadre en trois sous-ensembles : les rôles interpersonnels : symbole, leader et agent de liaison, les rôles liés à l’information : observateur attentif, diffuseur et porte-parole et les rôles décisionnels : entrepreneur, régulateur, répartiteur de ressources et négociateur [46]. Nous savons qu’ils n’arrêtent jamais de penser à leur activité professionnelle. Les PDG interviewés début des années 50 travaillaient 4 soirées sur 5 : une soirée au bureau, une soirée de réception et deux soirées au domicile qui est « moins un sanctuaire qu’une annexe du bureau » [47]. Il semble que ce rythme n’ait guère changé depuis.
Il n’est de pire patron que soit même. Plus on monte dans la hiérarchie, moins on constate que les individus sont prêts à mettre eux-mêmes en pratique une réduction du temps de travail, voire un début d’application du temps partiel. Le psychiatre Éric Albert confiait à une journaliste : « Les PDG, les cadres dirigeants en font l’éloge…pour les autres. Mais demandez-leur s’ils envisagent à leur tour d’opter pour un travail moins lourd. La réponse est immédiate et unanime : “Vous plaisantez. Nous faisons un travail beaucoup trop intéressant pour pouvoir l’exercer à temps partiel“. Il n’y a pas un grand groupe aujourd’hui dans lequel le président envisage une seconde que ses collaborateurs travaillent à temps partiel »[1]. Derrière cette attitude se trouve une assimilation erronée du temps partiel à une moindre implication et une moindre motivation au travail, un moindre engagement dans l’entreprise. S’engager dans le temps partiel, ce serait renoncer à vouloir prendre des responsabilités et à faire une carrière dans l’entreprise. En fait, au contraire, l’évaluation faite par certaines entreprises du travail à temps partiel conduirait plutôt à montrer qu’il entraîne des gains de productivité importants et il existe des entreprises qui accordent des garanties croissantes en termes de réversibilité et de mobilité [1].
Aujourd’hui la durée de travail des cadres dans les grandes entreprises a sensiblement augmenté. Ils ont des journées interminables, alors qu’auparavant cette situation était plutôt réservée aux cadres des PME. L’UCC-CFDT a réalisé fin 1995 une enquête auprès de 1003 cadres, issus pour 69% du secteur public et travaillant pour 85% d’entre eux hors de la région parisienne [48]. Elle a montré que la moitié travaillent plus de 46 heures par semaine, 23% entre 46 et 50 heures et 26% entre 51 et 60 heures. Seuls 10% effectuent réellement leurs 39 heures. En 1985, la moyenne se montait à 45 heures seulement.
Un des problèmes que rencontrent les cadres vient de l’absence de définition précise de leurs tâches ou de leurs fonctions. Ils ne peuvent pas bien savoir où s’arrête leur investissement personnel. Souvent les directions sous-entendent qu’ils n’en font jamais assez, de sorte qu’ils se sentent culpabilisés lorsqu’ils cessent de travailler. Ceci conduit à distinguer deux catégories parmi les cadres : ceux qui savent maîtriser leur emploi du temps et ceux qui sont toujours débordés. Alain Lebaube remarque à leur propos : « Un monde sépare les gens qui savent hiérarchiser, anticiper, ne pas se laisser envahir par les détails et les gens surchargés de travail, toujours en train de courir, s’époumonant d’un dossier important à une broutille, qui ne savent pas dire non et sont continuellement mis à contribution. Les premiers en imposent par leur calme. Les seconds semblent continuellement au bord de l’apoplexie ». [49]
Banalisés, les cadres n’acceptent plus la surcharge de travail sans contrepartie
La suractivité des cadres se révèle un mal très français. Les entreprises françaises ont augmenté leurs exigences. Certaines ont été séduites par le modèle japonais d’engagement affectif du cadre à l’entreprise, mais en en oubliant les contreparties, en particulier les devoirs de l’entreprise vis-à-vis de ses cadres. Alors que les cadres français avaient accepté, bon gré, mal gré, les dépassements d’horaires, depuis 1995, les salariés qui travaillent plus que la durée légale se sont mis à protester et ont demandé l’aide des inspecteurs du travail. Ce problème se trouve très lié à la question du contrôle du travail par le temps passé au bureau, formule dépassée mais qui garde l’avantage d’une facilité dont nombre d’entreprises françaises ont du mal à se passer.
Dans le modèle japonais, les cadres sont soumis à une sollicitation affective afin qu’ils prennent à cœur ce qui arrive à l’entreprise, qu’ils se consacrent pleinement à sa réussite et qu’ils donnent le meilleur de leur énergie. En contrepartie, ils reçoivent salaires et honneurs, l’entreprise prend en charge nombre d’aspects de leur vie personnelle, c’est ce qui rend le système cohérent.
Nombre de grandes entreprises françaises, séduites par le système japonais, en oublient une partie, essentielle. Elles pressurent les cadres, les stimulent dans un registre affectif, mais sans rien leur fournir en retour. Au centre de recherche de Renault à Rueil, un conflit lancé fin février 95 a donné l’occasion aux cadres et aux techniciens rémunérés au forfait de constater que la direction avait dépassé les bornes en annonçant qu’elle n’allait pas augmenter les salaires alors que les bénéfices se montaient à 3 milliards de F. Comme l’exprimait le délégué syndical CGT : « Les dépassements d’horaires (non payés) n’étaient pas contestés tant que les déroulements de carrière et les salaires étaient corrects. Mais là, ce n’était plus le cas» [50].
La surcharge de travail est fréquemment un motif de mécontentement pour les employés qui se rendent compte que les affaires reprennent, que la production augmente sans que l’entreprise embauche, ce qui signifie pour eux un accroissement de travail et de la fatigue. L’accroissement des horaires de travail va mal avec des situations où les directions veulent licencier, comme le dit un cadre technique de Siemens à propos de son entreprise « on nous explique d’un côté qu’il y a trop de personnel, et de l’autre on fait travailler les gens plus de 10h par jour »
Dans un certain nombre de cas les salariés, et même les cadres, ont réclamé le retour de la pointeuse, ou de sa version moderne, la machine où l’on met son badge électronique pour enregistrer son arrivée ou son départ des locaux de l’entreprise, la “badgeuse”. Ce système, qui sert de garde-fous, permet de contrôler, et si besoin de limiter, le temps de travail, les heures supplémentaires et les demandes excessives de la direction. De tels phénomènes se sont produits non seulement dans des établissements industriels, mais aussi dans des banques. A l’usine Lever d’Haubourdin dans le Nord, depuis le passage aux 32 heures avec annualisation pour éviter des licenciements, la pointeuse concerne l’ensemble des 457 salariés. Le fait de « badger » ne semble pas poser de problème pour les 16 cadres. Pour le délégué syndical CFDT de Thomson-CSF Airsystem (4000 salariés) «la réduction de temps de travail ne pourra être efficace que s’il y a un contrôle effectif du temps de travail par le biais d’une pointeuse avec possibilité d’horaires variables pour l’ensemble du personnel… Notre enquête montre que 70-80% des salariés sont favorables au contrôle du temps de travail, particulièrement les ingénieurs et cadres » [51]. À l’agence de la BNP de Bordeaux-Chapeau rouge, qui fut la première de la banque à avoir adopté le système de la « badgeuse », les salariés ont bien vécu sa réintroduction, car ils en retirent plus d’autonomie. De l’avis de Didier Arnaudet, secrétaire du Comité d’Etablissement « fini le stress en cas de retard, le matin. La machine enregistre l’heure d’arrivée et calcule le temps à rattraper. Un véritable carnet de bord» [52].
Dans l’esprit des patrons, les cadres étaient censés être payés au forfait et travailler sans compter leur temps. Depuis 1994, les inspecteurs du travail ont récusé l’usage, admis jusqu’alors, que les cadres travaillaient au forfait et ne devaient pas compter leur temps. Ils ont été soutenus par la Cour de cassation qui a considéré l’encadrement, exception faite des cadres de direction, comme étant soumis aux 39 heures. Pour se mettre en conformité avec la loi, les entreprises épinglées par l’Inspection du travail devront élaborer une convention individuelle précisant le nombre d’heures que recouvre le forfait convenu. Les heures supplémentaires seront rémunérées. D’après les calculs des syndicats de Thomson, les dépassements d’horaire au cours des 5 dernières années non payés aux cadres du groupe équivaudraient à 2,5 milliards de F [53]. La CGC estime que le contrôle des horaires des cadres est « rétrograde et incompatible avec leur fonction, qui est de remplir une mission ». Elle propose de négocier des contreparties aux heures supplémentaires, par exemple des comptes épargne-temps ou l’allongement de la durée des congés [54].
Face à tous ces abus, les inspecteurs du travail, de plus en plus souvent sollicités pour contrôler les horaires, sont démunis, car ils ne sont que 400 pour toute la France. Leur travail est devenu plus difficile avec l’augmentation de l’individualisation des horaires dans les entreprises. Une inspectrice de la région parisienne qui souhaitait contrôler les horaires des 30 salariés d’une entreprise de gardiennage a dû décrypter une liasse de relevés épaisse de 15 cm. [55]
La fragmentation du temps serait dans la nature du travail du cadre
Les cols blancs ont été beaucoup étudiés. La façon dont ils gèrent leur temps a été plus étudiée en Amérique du Nord qu’en Europe. Les travaux d’Henry Mintzberg montrent que les cadres, perpétuellement préoccupés, ont tendance à éviter la routine et à privilégier les tâches spécifiques. La fragmentation du temps de travail tient à la nature de leurs tâches, oui, mais ils aiment ça. Cette capacité à passer d’un sujet à l’autre, appréciable et utile dans certaines circonstances, entraîne des dérives nuisibles, superficialité, dispersion et perte de la capacité de réflexion.
Le travail du cadre s’inscrit, par sa nature même, dans «la brièveté, la variété et la fragmentation », comme le dit Henry Mintzberg. [56] Le passage d’une activité à une autre semble inhérent à sa fonction. Les activités courantes et les activités très importantes se succèdent sans que l’ensemble ait une structure particulière. Souvent, il passe d’un partenaire, d’un client, d’un pays à un autre au cours de sa journée. En plus des tâches spécifiques à son activité, réunions à mener, résultats à atteindre, délais à tenir, une série d’événements peut à tout moment perturber l’ordonnancement de sa journée de travail : questions des collaborateurs, urgences, rappels à l’ordre, conseils, etc. La nécessité économique l’oblige à assumer des tâches plus nombreuses et plus diversifiées. La diversité des interruptions apporte de la diversité à son travail, sans lesquelles il risquerait de tomber dans la monotonie.
Comment décrire cette fragmentation du temps, caractérisée par de fréquentes interruptions ? Les statistiques nous donnent deux indicateurs complémentaires : le nombre moyen d’interruptions dans la journée et la durée moyenne de la période consacrée à un seul sujet, en continu, sans interruption. Nombre d’auteurs indiquent le temps moyen entre deux interruptions qui va de 7 minutes pour Bruno Jarrosson [57] à 17 minutes pour 70% des cadres, selon l’enquête de Time System [58]. Henry Mintzberg conclut de ses observations que «la brièveté de beaucoup d’actions du cadre est aussi très surprenante »[59]. La moitié d’entre elles avaient une durée inférieure à 9 minutes, et seulement 10% excédaient une heure. Les conversations téléphoniques étaient brèves et précises, 6 minutes en moyenne. Les périodes de travail au bureau et les réunions non programmées duraient rarement plus d’une demi-heure. Leur moyenne était respectivement 15 et 12 minutes. Seules les réunions programmées prenaient souvent plus d’une heure avec une moyenne de 68 minutes. Le romancier Douglas Coupland, qui a passé près d’un mois chez Microsoft avant d’écrire son roman, fait dire à un de ses personnages de Microserfs « J’ai développé un mini programme où je clique chaque fois que je suis interrompu — un coup de fil, une question, changer la bande du walkman. Temps moyen entre deux interruptions : 12,5 minutes » [60].
La fragmentation du temps de travail est un phénomène de société
Cette fragmentation, cet émiettement du temps n’est plus lié au statut, ni même aux seules activités au travail. [61]. Les médecins ont observé que les hommes et les femmes ne vivent pas le temps de la même manière et, par conséquent, tendent à adopter différents modes d’organisation de leur temps. « L’on s’aperçoit, en effet, que sur 24 heures, la femme fonctionne par petites plages morcelées, et l’homme par grandes plages ; que les loisirs de la femme sont, en fait, contaminés par de nombreuses occupations matérielles (elle tricote par exemple en regardant la télévision) » [62]. Mais, cette fragmentation est plus visible dans le cadre d’une activité professionnelle. Il suffit d’observer une personne en charge d’accueillir du public pour s’en convaincre. C’est encore plus vrai pour celle qui doit faire face à des appels téléphoniques. Cet émiettement du temps concerne la majorité des cols blancs et nombre d’autres catégories d’actifs, cela s’explique par plusieurs raisons. Tout d’abord, le nombre de personnes avec lesquelles nous sommes amenés à entrer en relation a augmenté considérablement et les « infotechnos » nous permettent de les joindre quasiment dès que nous en avons envie. Un homme comme le père minime Marin Mersenne, qui a entretenu pendant plus de 20 ans au XVIIe siècle une correspondance avec plus de 300 personnes dans l’Europe entière pouvait compter sur des matinées ou des après-midi entières pour s’occuper tranquillement de son courrier ou de ses recherches. Aujourd’hui, le téléphone nous dérange quasiment partout et tout le temps. Dans une organisation qui réclame sans cesse plus d’autonomie et de sens de l’initiative, le col blanc moderne a besoin de rester à l’écoute, de se tenir à l’affût des informations et de les rediffuser ensuite. Une partie de sa tâche consiste justement à répondre à des sollicitations et à susciter des réponses. Beaucoup gardent leur porte ouverte ou ne filtrent pas leurs appels téléphoniques pour ne pas risquer de perdre une information qui pourrait s’avérer capitale pour leur activité. D’autres en arrivent au point de passer la journée entière enfermé dans leur bureau, donnant des coups de téléphone dans le monde entier, sans communiquer avec leurs voisins, autre paradoxe de la « société de communication » qui n’en manque pourtant pas.
Cependant, une différence existe entre le fait de répondre aux sollicitations, par exemple dans les fonctions qui nécessite le face à face avec du public. Celui de papillonner dans un « babillard » électronique sous prétexte de ne pas laisser passer une occasion de s’informer, en passant systématiquement d’un sujet à l’autre, de façon similaire au zapping à la télévision, ou encore de faire le choix délibéré de ne pas approfondir un dossier ennuyeux. Certains sont passés maître dans l’art de refiler la besogne embarrassante à un confrère « plus compétent » ou à faire circuler dans les réseaux une sollicitation à laquelle ils n’ont pu répondre.
Les agents de maîtrise sont aussi concernés. Henry Mintzberg remarque aussi que la brièveté et la fragmentation ne concernent pas que les cadres. Pis encore, des chercheurs américains des années 50 ont observé que la durée moyenne des tâches des agents de maîtrise était encore plus brève que celle des cadres, entre 1 et 2 minutes. Une étude a évalué qu’ils accomplissaient entre 237 et 1073 activités par jour. « Ces agents de maîtrise avaient, évidemment, peu de temps pour souffler. Ils avaient à résoudre « en rafale » de nombreux problèmes pressants. Il leur fallait accepter d’être fréquemment interrompus, de garder simultanément à l’esprit de nombreux problèmes, et de redéfinir sans cesse les priorités d’action. » [63]
Les particularités du temps des cols blancs tiennent à la nature même de leurs tâches. Sa fragmentation s’avère essentielle et utile, mais risque d’entraîner des dérives sources d’inefficacité. Les dérives de superficialité et de dispersion sont un des risques des métiers modernes. La capacité à régler de la façon la plus rapide qu’il soit est d’ailleurs devenue un critère de recrutement. Reste qu’un nombre croissant de personnes se mettent à « surfer » sur les problèmes sans prendre le temps de les approfondir. La résolution d’un problème passe par l’usage de plus en plus fréquent des télécommunications, « est-ce que tu connais quelqu’un qui… ? », « Est-ce que vous savez si… ? » ; Il s’agit, dans un minimum de temps de contacter un maximum de gens susceptibles d’apporter une solution ou une partie de la solution. L’approche nerveuse et réactive des nouveaux temps modernes conduit parfois à ne rien régler dans le fond, à seule fin de pouvoir en faire davantage ou… à le feindre.
Si cette capacité de passer d’un sujet à un autre est appréciée et utile dans certaines circonstances, il peut s’avérer dangereuse pour des esprits faibles ou mal structurés. Un col blanc qui passe sa journée en des taches morcelées et peu exigeantes est tenté de continuer sur le même mode quand il doit se livrer à un travail de réflexion, traiter un problème de manière un peu plus approfondi. Après avoir passé plusieurs heures à « commuter » au téléphone, on a du mal à reprendre le fil d’une réflexion plus abstraite et soutenue. Lorsqu’il se trouve seul dans son bureau et qu’il s’aperçoit plus ou moins consciemment qu’il a des difficultés, il lui est plus rassurant et plus facile de multiplier les interruptions que de rester seul face à ses difficultés.
Des études ont montré que ceux qui étaient le moins dérangés s’interrompaient d’eux-mêmes dans leur travail, comme si ce « zapping » leur était devenu indispensable. Parfois, cadres ou non, ils se constitueront une organisation du travail qui permette de les perturber, de les interrompre. Peut-être doutent-ils d’eux même, de leur valeur. Quoi qu’il en soit l’ensemble de ces phénomènes d’émiettement du temps de travail nuit à la performance globale de l’entreprise. Mais ce n’est pas tout.
Dans la mesure où le travail ne s’évalue plus à l’apparence des salariés devant leur bureau, comment savoir si celui qui réfléchit, immobile dans ses pensées, s’occupe effectivement d’une question relative à l’entreprise ou d’un problème personnel ? Comment savoir l’intérêt et l’importance de la conversation téléphonique que tient cet employé depuis un bon moment, pour l’entreprise ? Cette difficulté à distinguer un salarié “normal” d’un inactif conduit parfois à une recrudescence du nombre de ceux qui essaient de travailler le moins possible. Elle obligera l’entreprise à s’engager dans le post-salariat et dans une relation de confiance envers ses collaborateurs, elle n’a pas le choix.
Dans certaines entreprises, c’est l’organisation elle-même qui encourage à en faire le minimum, à inventer mille et une astuces pour contourner les exigences du patron, comme l’écran de l’ordinateur programmé pour changer en permanence et faire croire que l’on vient de partir à l’instant [64]. Certaines directions, qui sont convaincues que la qualité du « collectif intelligent » est une clé du succès, se posent la question : pourquoi les salariés, quel que soit leur rang hiérarchique, donnent-ils des signes aussi évidents de leur désengagement ? D’autres, restant favorables aux bonnes vieilles recettes utilisent les « infotechnos » pour asservir un peu plus leurs personnels.
- Les « infotechnos » mouchards des temps modernes
Comme à toute heure du jour et de la nuit un endroit de la planète se trouve en situation « normale » de travail, les réseaux et les ordinateurs permettent d’être tout le temps en ligne avec des personnes qui sont « normalement » au travail. A cela s’ajoutent les astreintes, qui obligent des salariés à être disponibles en permanence, 24 heures sur 24.
A cela s’ajoute les possibilités offertes par les nouvelles technologies qui entraînent des tentations auxquelles les chefs d’entreprise ont du mal à résister, comme celle de pouvoir joindre ou de surveiller leurs collaborateurs où qu’ils soient. De plus en plus de salariés ne prennent jamais de vraies vacances, puisqu’ils doivent toujours être joignables, même à des milliers de kilomètres. Le panoptique de Jeremy Bentham (1748-1832), qui a servi de modèle théorique pour l’organisation des usines et la gestion des entreprises depuis la fin du XVIIIe siècle, prend des dimensions nouvelles. Il avait proposé ce modèle architectural constitué d’une tour centrale, entourée d’un bâtiment circulaire, qui devait permettre au pouvoir de voir ses sujets à n’importe quel moment, tout en étant lui-même visible mais invérifiable. Avec les téléphones mobiles et les futurs réseaux de satellites intercontinentaux comme Iridium, il sera possible de contacter un abonné où qu’il soit, dans le monde entier, sans connaître sa localisation. Comme le dit Nicholas Negroponte, directeur du Media Lab du MIT, l’ancien hymne à la mobilité moderne « tout, quand je veux, où je veux », va se transformer dans le slogan « rien, jamais, nulle part » à moins que cela ne tombe à pic, que ce soit important, pertinent, ou capable de séduire mon imagination [65]. Certes, mais pour les barbares, les « infotechnos » ne sont qu’un nouvel instrument pour contrôler et encadrer leurs troupes !
Le contremaître électronique
« Le 18 janvier, vous êtes arrivé à 8h35. A 9 heures, vous vous êtes absenté dix-sept minutes sans justification. Entre 11h 27 et 11h 48, vous avez quitté une nouvelle fois votre poste. Si j’ajoute le temps de délégation que vous avez utilisé pour le comité d’entreprise, votre présence active ne représente, ce jour, que 65% de votre emploi du temps » (55). Tel est l’entretien individuel que dû subir un employé abasourdi face à un cadre qui avait en sa possession le relevé de tous les numéros de téléphones internes et externes appelés durant les trois derniers mois. Une pratique qui, si elle reste rare, n’est plus exceptionnelle. Surtout lorsqu’il s’agit de faire entendre raison à un salarié qui en prend à son aise avec l’emploi du temps.
La sophistication des outils de commutation téléphonique et de gestions de l’utilisation individuelle des ressources technologiques se prête aisément à des usages discutables de surveillance et d’encadrement du personnel. Chez BellSouth, qui développe des services de centres d’appels et de services réseaux, l’encadrement « observe » (c’est le terme employé) les conversations téléphoniques pour contrôler en direct la qualité du travail des opérateurs en communication avec un client. Cette pratique n’est pas une généralité en France, loin de là. Lors d’interventions de schémas directeurs de communication qui nous amenaient à analyser les relations les plus intenses entre les établissements ou les régions grâce à l’utilisation des données enregistrées par les logiciels de leurs autocommutateurs. Notre client, neuf fois sur dix, soit ne connaissait pas cette possibilité, soit ne l’utilisait pas, y compris pour maîtriser mieux sa facture téléphonique. Mais le risque de dérive est là, comme la tentation d’abuser de l’usage normal de surveillance.
En août 1994, un rapport de l’O.I.T. dénonçait la « perte de vie privée » des salariés sur leur lieu de travail. Il révélait que les « infotechnos » permettent « désormais aux employeurs de surveiller leurs salariés dans la quasi-totalité de leurs activités au travail ». La capacité inquisitoriale des instruments désormais à la disposition des entreprises ne connaît pas de limites. Ces outils peuvent se répandre presque par inadvertance, sans véritable décision. Badge, vidéo-surveillance, autocommutateur, logiciel informatique : la panoplie des techniques de contrôle a largement conquis les entreprises françaises et placé le salarié sous haute surveillance. La banalisation même de certains modes de surveillance peut conduire à en minimiser l’impact : « Des caméras, il y en a partout : dans le métro, dans les rues, alors pourquoi pas dans les entreprises ? C’est devenu relativement admis et les employés se plaignent peu » souligne un inspecteur du travail. [66] Un contrôleur du travail de Paris constatait que l’accroissement du contrôle par les NTIC échappe souvent aux salariés : « On a le sentiment apparent d’une plus grande liberté [avec les NTIC], mais ce n’est qu’une illusion… Il y a peu, les horaires de travail étaient scandés collectivement par la pointeuse, à laquelle seuls les cadres échappaient. Désormais, avec les horaires variables, les salariés sont badgés, ce qui correspond finalement à un perfectionnement du contrôle ». [67]
Les badges permettent de contrôler les déplacements des salariés ou de suivre à la trace leurs déplacements. Il sert aussi à contrôler le temps passé par un individu à ses différentes occupations, son heure d’arrivée et de sortie de l’entreprise. On observe aux USA la multiplication de l’incitation du port de badge par les salariés, ayant pour conséquence l’accroissement d’un travail plus observé au nom de la protection individuelle ! Le badge ne constitue pas le seul élément permettant de suivre un individu à la trace. Une carte de crédit fournit un relevé détaillé des opérations effectuées par son possesseur. Ainsi un chauffeur routier peut être suivi à la trace chaque fois qu’il achète du carburant, paie un péage autoroutier, déjeune au restaurant, etc. L’individu peut-être plus surveillé. À tout moment, on peut le prendre lui, comme objet d’information, et l’insérer dans tout un système de contrôle qui en lui laissant sa liberté individuelle « apparente », peu à tout moment, permettre d’exercer sur lui des mesures de rétorsion ou de chantage. C’est cela le grand changement. Autrefois le contremaître jouait un peu l’équivalent de « la peur du gendarme ». Le voir ou savoir qu’il pouvait intervenir à tout moment calmaient les uns, stimulaient les autres, modéraient les paresseux. Aujourd’hui c’est bien d’un viol de l’intimité des personnes dont il est question. C’est cela les nouveaux temps modernes.
Les autocommutateurs permettent d’enregistrer les appels et leur durée pour chaque poste, mais aussi maintenant de les écouter. Marie Jacek, membre du secteur droits et libertés de la CGT, confiait à un journaliste : « La difficulté, avec ce genre de technologie, c’est que dans la plupart des cas, les employeurs les utilisent à l’insu des salariés. Nous avons eu le cas d’une entreprise qui enregistrait les conversations téléphoniques de ses employés. Lorsque le système a été découvert, la direction s’est justifiée en précisant qu’il s’agissait d’une « nouvelle méthode de formation continue » !» [68]
Les systèmes de vidéo-surveillance fournissent des informations encore plus personnalisées : l’attitude sur le poste de travail, les déplacements, les amitiés ou inimitiés, tous ces actes sont détectés, filmés et peuvent être utilisés. Selon American Management Association, 35% des sociétés américaines surveillent les appels téléphoniques, les messageries vocales et les fichiers personnels. Un peu moins d’un quart reconnaissent le faire à l’insu de leurs personnels, 37% vérifient les numéros appelés par les employés et le temps passé ; 16,2% vérifient la quantité de frappe. L’utilisation de la surveillance par caméra représente 34% des entreprises interrogées. Selon l’AMA, certaines sociétés espèrent coincer ainsi des salariés indélicats ; il s’agit essentiellement de contrôler les usages non autorisés des matériels des compagnies, comme de passer des coups de fils longues distances, d’utiliser Internet pour s’amuser. (CI du 2/7/97).
De nouvelles possibilités de contrôle
Ces nouvelles techniques de surveillance permettent d’appliquer un contrôle de la productivité dans des activités qui jusqu’ici ne s’y prêtaient guère. Comme cette société parisienne de service d’assurances où les chargés de clientèle qui travaillent par téléphone sont individuellement repérés sur l’écran informatique de leur chef. À tout moment, ce dernier peut savoir combien d’appels sont traités par tel ou tel poste, le nombre d’appels en attente, la durée moyenne des communications, les temps de pause, etc. [69]
Elles sont aussi appliquées pour surveiller les jeux sur les ordinateurs de bureau. Un logiciel antijeu fouille les entrailles des disques durs pour détecter et supprimer jusqu’au dernier Solitaire. Après les logiciels « dressés » à traquer les virus, nous avons maintenant les « chasseurs » de jeux. Manié par un surveillant de réseau informatique, l’outil développé par l’américain DVD Software et commercialisé en France par Apsydoc, peut se révéler une arme redoutable. En effet, UnGame, c’est son nom, épie chaque ordinateur, compare les programmes qu’il contient à sa liste noire de 4500 jeux et une fois localisé le Solitaire ou la réussite interdite, le tue impitoyablement à distance.
Les producteurs d’UnGame mettent en avant une étude américaine de Colemans Associates, selon laquelle le coût annuel des jeux en entreprise s’élèverait à 50 milliards de $. Ces jeux informatiques volent de la place sur les disques durs, dégradent les performances des systèmes et risquent d’introduire des virus dans les réseaux. Dans une grande entreprise française le responsable du réseau note que certains jeux peuvent même bloquer les échanges de documents entre ceux qui travaillent. Dans ce cas, la politique de l’entreprise consiste à « appeler les personnes qui jouent et à leur faire la morale » [70].
L’apparition des logiciels de filtrage privés sur Internet a amplifié la surveillance dans ce domaine. Destinés au départ aux parents qui voulaient empêcher leurs enfants de consulter certains sites qu’ils jugeaient dangereux ou indécents, ils sont maintenant utilisés par les entreprises qui veulent faire leur propre censure. Compuserve a conclu un accord avec la société américaine Microsystems Software de Framingham (Mass.), afin d’offrir à ses abonnés le logiciel « Cyber Patrol Internet ». Ce dernier compte parmi les plus élaborés des logiciels de filtrage et autorise une véritable gestion de l’accès. Les patrons peuvent limiter l’utilisation d’Internet à certaines heures et fixer une durée journalière maximale de connexion. Le cœur du système est constitué par le filtrage des sites, avec une liste de 6000 sites « douteux ». A l’usage, Cyber Patrol se révèle efficace. Il est compatible avec tous les systèmes d’exploitation et tous les navigateurs. Activé dès le démarrage de l’ordinateur, il fonctionne de manière automatique. Dès que l’accès à un site interdit est demandé, il intervient et bloque toute connexion. La fiabilité du système sur les nouveaux sites qui ne sont pas encore référencés dans la « liste rouge » reste douteuse. Internet est le siège d’une telle ébullition que la mise à jour des sites interdits est cruciale pour la crédibilité de cette solution. Il suffit en effet de modifier certains noms pour échapper à la surveillance de Cyber Patrol. Quels que soient les moyens de contrôle, il est probable qu’une solution de contournement sera découverte par les plus curieux des cybernautes [71].
Malgré tout, le pire est peut-être encore à venir. De nouvelles techniques vont augmenter les possibilités de surveillance. Les ingénieurs envisagent des caméras vidéo ultrasensibles qui verront à travers les murs et fouilleront les « suspects » à distance, fouinant sous leurs vêtements et dans leur corps. Glissées dans le combiné d’un téléphone, les puces renifleuses pourraient analyser l’haleine de l’interlocuteur, permettant aux médecins de suivre leurs patients à distance. De même, elles pourraient à l’insu des intéressés fournir de précieuses informations sur leur état de stress — par exemple au cours de négociations délicates [72].
Si surveiller officiellement le personnel n’a rien de délictueux, devenir à son insu l’objet d’une surveillance doit constituer un délit, un manquement grave à l’éthique.
[1] Jean Chesneaux, « L’axe passé-présent-avenir », Transversales Science Culture n° 26, mars-avril 94
[2] Jean-Louis Servan-Schreiber, L’art du temps, Fayard, 1983
[3] Bernard Ibal, « Nous avons mal au temps », Le Monde, 12/6/1996
[4] Jean Chesneaux, « L’axe passé-présent-avenir », Transversales Science Culture n° 26, mars-avril 1994
[5] Edward Hall, La danse de la vie, temps culturel, temps vécu, Seuil, 1984
[6] Jean-Louis Servan-Schreiber, L’art du temps, Fayard, 1983
[7] ibid.
[8] Bruno Jarrosson, « De l’urgence de la lenteur », tribune libre, Les Echos, 3/7/1996
[9] cf. Edward Hall, Le langage silencieux, Points 1984 (éd. Originale 1959)
[10] cf. Edward Hall, La danse de la vie, temps culturel, temps vécu, op. cit.
[11] Marie-Béatrice Baudet, « L’ordinateur, le client et le vendeur », Le Monde, 14/11/95
[12] Bruno Jarrosson, « De l’urgence de la lenteur », tribune libre, Les Echos, 3/7/96 (date à vérifier)
[13] Michel Crozier, « L’homme encombré », Prospective n° 15, avril 1969
[14] Jean-Pierre Dupuy et Jean Robert, La trahison de l’opulence, PUF, 1976
[15] Edward T. Hall, Le langage silencieux, Points 1984 (éd. Originale 1959), ch. 1 les voix du temps
[16] Francine Aizicovici, « Travailler contre la montre », LM, 4/10/95
[17] Pierre Drouin, « Mouvement perpétuel », LM, 20/5/95
[18] Sten Nadolny, La découverte de la lenteur, Grasset, 1985
[19] Edward T. Hall, Le langage silencieux, op. cit.
[20] Laetitia Van Eeckhout, « Les jeunes actifs sont les plus optimistes », Le Monde, 23/10/1996
[21] Frédéric Lemaître, « Durée légale et durée réelle du travail sont de moins en moins liées », Le Monde, 21/12/1995
[22] Laetitia Van Eeckhout, « Les jeunes actifs sont les plus optimistes », Le Monde, 23/10/1996
[23] cf. Gabrielle Roland, Seront-elles au rendez-vous ? La nouvelle cause des femmes, Flammarion, 1995
[24]cf. L’état de la France 96-97, La Découverte, 1996
[25] Guillaume Malaurie, « Ces millions de Français qui travaillent trop », op. cit.
[26] Natacha Tatu, « Grande-Bretagne : l’envers d’un modèle », Le Nouvel Observateur, 28/11/1996
[27] IFOP…
[28] Natacha Tatu, « Cadres : halte aux cadences infernales ! », Le Nouvel Observateur, 14/3/1996
[29] Lionel Steinmann, « Ils me tuent au travail », L’expansion, 24/10/1996
[30] Natacha Tatu, « Cadres : halte aux cadences infernales ! », op. cit.
[31] Working on the Infobahn, discours de Peter Johnston, DG XIII, CEE, 13/01/1995
[32] Marie-Claude Betbeder, « Mémoire de grèves », Le Monde, 17/1/1996
[33] Chiffres de l’enquête du Min. du Travail, études DARES de 1991 et 1993 sur les conditions de travail
[34] Guillaume Malaurie, « Ces millions de Français qui travaillent trop », L’Express, 17/10/1996
[35] Jacqueline de Linares, « Cadres : la révolte », L’événement du jeudi, 28/11/1996
[36] IFOP, « Les Français, le chômage, leur rapport au travail », sondage pour Libération, novembre 1993
[37] Guy Aznar, Répertoire 1994 des « innovations temps de travail », CATRAL, 1994
[38] Claire Guélaud, Yannick Le Bourdonnec; Stéphane Lupieri, Marie-Paule Virard, « Carrière, les nouveaux choix de vie », Enjeux Les Échos, sept. 1996
[39] Martine Gilson, « Travailler moins pour travailler tous », Le Nouvel Observateur, 28/11/1996
[40] ibid.
[41] Philippe Baverel, « La moitié des cadres travaillent plus de 46 heures par semaine », Le Monde, 20/3/1996
[42] Entretien avec Eric Albert
[43] Florentin Collomp, « Voici les nouvelles règles du « bien partir » en vacances », L’Expansion, 11/7/1996
[44] Philippe Baverel, « La moitié des cadres travaillent plus de 46 heures par semaine », Le Monde, 20/3/1996
[45] Martine Gilson, « Travailler moins pour travailler tous », op. cit.
[46] Henry Mintzberg, op. cit.
[47] W. H. Whyte Jr, « How Hard Do Executives Work ? », Fortune, Janvier 1954
[48] Enquête sur les lieux, les outils et les temps de travail des cadres, UCC-CFDT, 1995
[49] AL, « Gérer son temps », LM, 4/10/95
[50] Francine Aizicovici, « La grogne des cols blancs », Le Monde, 21/2/1996
[51] Clarisse Fabre, « Des salariés réclament le retour de la pointeuse », Le Monde, 10/7/1996
[52] Clarisse Fabre, « Des salariés réclament le retour de la pointeuse », Le Monde, 10/7/96
[53]« Heures supplémentaires : oui, le cadre y a droit », L’expansion, 24/10/1996
[54] Clarisse Fabre, « Des salariés réclament le retour de la pointeuse », Le Monde, 10/7/96
[55] Lionel Steinmann, « Ils me tuent au travail », op. cit.
[56] Henry Mintzberg, op. cit.
[57] Bruno Jarrosson, Briser la dictature du temps, Maxima Laurent du Mesnil, 1993, 1996
[58] Capital, mai 1996
[59] Henry Mintzberg, op. cit.
[60] Douglas Coupland, Microserfs, J.-C. Lattès, 1996
[61] Bruno Jarrosson, « De l’urgence de la lenteur », tribune libre, Les Echos, 3/7/96 ( Le zapping temporel sera à l’origine des réflexions sur l’économie de l’attention)
[62] cf. Claude Leroy, « Essai kaléidoscopique sur quelques aspects de la pathologie due au temps », in Alain Reinberg (sous la direction de), L’homme malade du temps, Stock, 1979
[63] Henry Mintzberg, op. cit., citant R. H. Guest, « Of Time and the Foreman », Personnel, 1955 : 32, pp. 478-486
[64] cf. Sue Shellenberger, « L’art et la manière de passer pour u bourreau de travail », Wall Street Journal, in Courrier International, 9/2/1995. Cet article donne une liste d’astuces fréquemment utilisées par les salariés américains pour faire croire qu’ils sont au travail sans y être réellement
[65] Negroponte, Nicholas, L’homme numérique, Paris : Laffont, 1995
55 Evenement du Jeudi Pascal Menigoz 4.6.97
[66] Nathalie Mlekuz, « Un dispositif juridique établit des garde-fous », Le Monde, 10/7/1996
[67] Marie-Béatrice Baudet, « Les nouveaux visages de la subordination », Le Monde, 17/10/1995
[68] Olivier Piot, « Le travail et la vie privée sous l’œil électronique », Le Monde, 10/7/1996
[69] ibid.
[70] Michel Alberganti, « Big Brother traque les jeux — Un logiciel « chasseur » surveille les ordinateurs de bureau », Le Monde, 6/4/1996
[71] Michel Alberganti, « Le débat se poursuit en Allemagne sur le contrôle de l’information en ligne », Le Monde, 13/3/1996
[72] Andy Coghlan, Vincent Kiernan, Justin Mullinsnew, « Le meilleur des mondes sera numérique », New Scientist, in Courrier International, Innovations 1997, octobre 1996