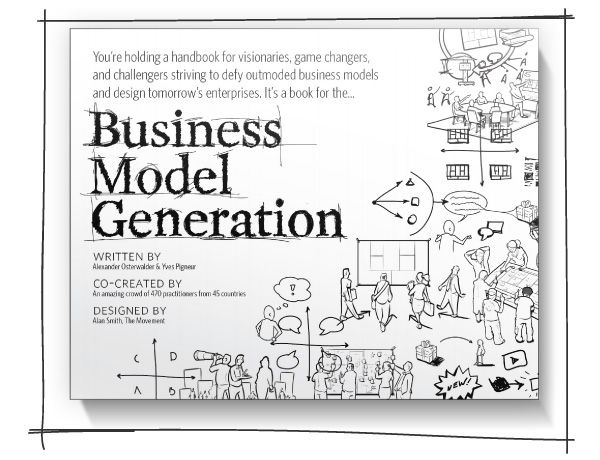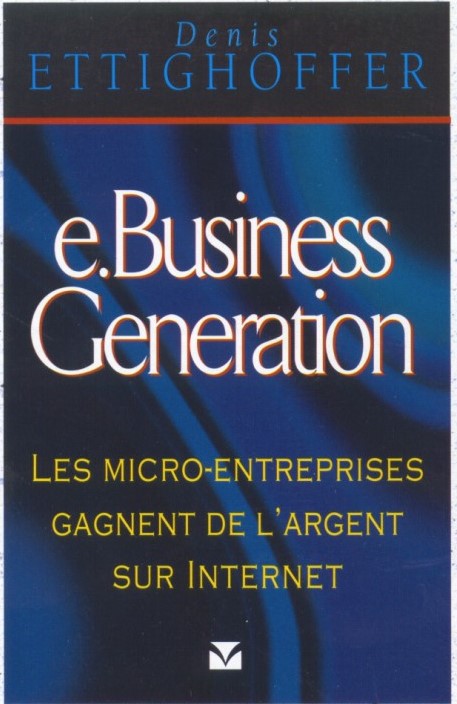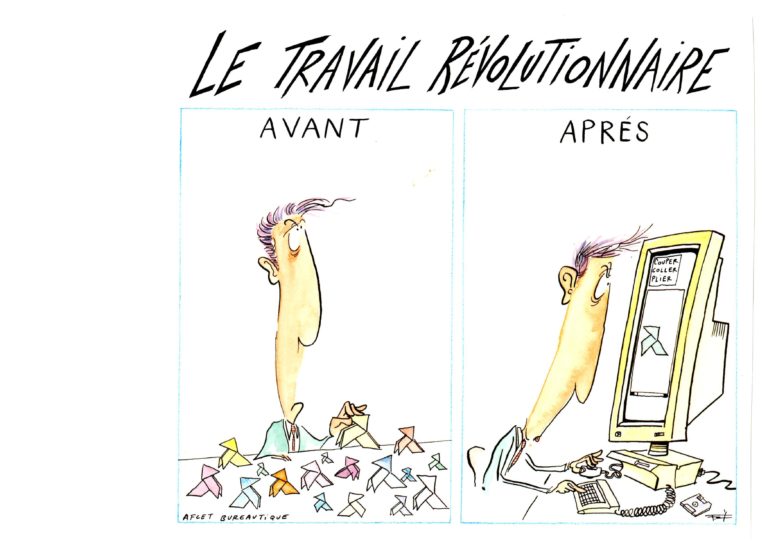Le développement de l’économie a toujours coïncidé avec celui des inventions qui ont jalonné son histoire. La plupart du temps, il s’agit de nouvelles découvertes technologiques, telles que la machine a vapeur, l’électricité ou l’ordinateur. Plus rarement, ces inventions se produisent dans le domaine de l’organisation du travail lui-même comme j’ai pu le démontrer dans « l’Entreprise Virtuelle et les nouveaux modes de travail » et… plus tard, dans « Mét@organisations, les nouveaux modèles de création de valeur »[1]. Grâce aux possibilités offertes par les télécommunications les entreprises ont inventé une nouvelle forme d’organisation internationale du travail que Charles Gave désigne sous le terme de société « plate-forme »[2]. Pour expliquer cette nouvelle organisation globale où la marque dominante assure le montage du produit fini, Charles Gave prend l’exemple de Dell, le producteur d’ordinateurs de bureau bien connu. Dans cette entreprise, tous leurs ordinateurs sont conceptualisés dans leurs centres de recherche, en particulier au Texas. Pour ainsi dire, aucune de leurs machines vendues aux Etats-Unis n’est construite sur place. Elles sont toutes fabriquées au Mexique ou en Chine et importées personnalisées dans le pays du client final au fil des commandes, par exemple aux Etats-Unis. Pour l’instant, rien que de très normal. La ou l’originalité apparaît, c’est dans le fait que Dell ne possède pas les usines dans lesquelles ses machines sont assemblées. La seule chose que fait l’entreprise Texane est de préciser dans les moindres détails les caractéristiques techniques que devront avoir ses ordinateurs. Ensuite, des industriels indépendants de Dell s’engagent à les produire, au coût fixé par le Texas. Des trois fonctions nécessaires à la vente d’un produit- conceptualisation, fabrication, vente. Dell a réussi à externaliser la plus dangereuse et la plus cyclique : la fabrication. Et cette réussite a de considérables implications macroéconomiques dont Charles Gave pense qu’elles ne sont pas bien comprises.
 En fait pour bien faire comprendre au lecteur ce que Charles Gave veut dire, on peut essayer de résumer son approche de la chaîne de la valeur de la façon suivante : Imaginons qu’un ordinateur Dell se vende aux Etats-Unis pour 700 dollars. Imaginons également qu’il est construit en Asie. Sur les 700 dollars de la vente, voila ce qui ira aux entreprises américaines : 200 dollars à Microsoft pour Windows, avec une marge de 90 %, soit 180 dollars. Cette machine aura besoin d’une puce de qualité, provenant sans doute d’Intel, sur laquelle la marge est de 75 % et dont le coût avoisinera les 70 dollars. La marge d’Intel par machine sera donc de 52.5 dollars. Quand cet ordinateur sera vendu, Dell prélèvera pour sa part une marge de 15% sur chaque ordinateur vendu soit 105 dollars. La partie délocalisée sera composée de l’écran plat qui sera fabriqué à Taiwan pour un coût de 135 dollars et avec une marge de 10 % soit 13,5 dollars. L’équipement électronique et le clavier seront fabriqués quelque part en Chine, pour un coût de 165 $, supportant une marge de 10 %, (soit 16.50$). Conclusions, sur les 700 dollars, les marges laissées aux entreprises américaines seront d’environ 337 dollars. En revanche sur les 300 dollars imputables à la fabrication asiatique, la marge sera d’environ … 30 dollars ! Le modèle de la « plateforme » met à contribution une production « chip » délocalisée en laissant la créativité et la conception à forte valeur ajoutée intellectuelle dans les bureaux d’études, ce qui permet une forte augmentation de la rentabilité du capital investi, une réduction drastique de la part laissée au travail grâce à une meilleure organisation des facteurs de production. Pour Charles Gave, il est à peu près certain que ce modèle va continuer à se développer puissamment dans les années qui viennent. Chaque société industrielle ou commerciale soumise à la pression des coûts de production des pays en plein essor économique devra se spécialiser dans les secteurs où elle a une forte valeur ajoutée et laissera le reste à des sous-traitants. Ce redéploiement explique pourquoi la rentabilité du capital de la production est moins importante dans les pays producteurs[3]. L’ensemble des entreprises américaines qui ont investi des milliards de dollars en Chine ont des profits qui n’ont pas dépassé les 2,4 milliards en 2003, alors que celles qui ont investis en Australie ont engrangés quelques 7,1 milliards et celles qui ont parié sur Taïwan ont récolté 8,9 milliards de dollars[4]. Il est difficile d’affirmer le différentiel du coût du travail soit à l’origine de telles différences. Les failles logistiques, la faiblesse locale de la demande et du système bancaire aux particuliers et bien d’autres facteurs encore limitent le rendement du capital dans certains pays alors que d’autres offrent une valeur ajoutée immatérielle plus conséquente. Ce que l’on peut en dire c’est que la production reste – comme au bon vieux temps de la production agricole – le parent « pauvre » de la chaîne de la valeur. On l’observe en France encore aujourd’hui. Celui qui gagne sera celui qui saura optimiser son bénéfice fiscal et sa marge de distribution car la marge ce sont les intermédiaires commerciaux qui l’a font, comme toujours. Dans la réalité, la rentabilité de l’opération est presque complètement en faveur du maître d’œuvre qui détient le portefeuille clients, c’est-à-dire le réseau commercial. En d’autres termes les « économies d’échelles » vont à la production mais le bénéfice des « ordres de grandeur croissantes » vont à celui qui maîtrise la distribution. Ceci explique que les consommateurs occidentaux – qui possèdent le pouvoir d’achat – tirent parti du pouvoir de négociation de leurs multinationales. Un pouvoir d’autant plus important que leur travail reste très chèrement payé, alors que celui de l’asiatique ne l’est pas. Tout le monde y gagne, explique Charles Gave : les travailleurs des pays en développement, parce qu’ils ont du travail, les acheteurs occidentaux parce qu’ils obtiennent des prix plus attractifs alors que leur niveau de vie plus élevé tire une production des pays sous traitants beaucoup plus fortement que si elle était fabriqué aux Etats-Unis ou en Europe. De plus la rentabilité globale des capitaux investis devient plus intéressante:
En fait pour bien faire comprendre au lecteur ce que Charles Gave veut dire, on peut essayer de résumer son approche de la chaîne de la valeur de la façon suivante : Imaginons qu’un ordinateur Dell se vende aux Etats-Unis pour 700 dollars. Imaginons également qu’il est construit en Asie. Sur les 700 dollars de la vente, voila ce qui ira aux entreprises américaines : 200 dollars à Microsoft pour Windows, avec une marge de 90 %, soit 180 dollars. Cette machine aura besoin d’une puce de qualité, provenant sans doute d’Intel, sur laquelle la marge est de 75 % et dont le coût avoisinera les 70 dollars. La marge d’Intel par machine sera donc de 52.5 dollars. Quand cet ordinateur sera vendu, Dell prélèvera pour sa part une marge de 15% sur chaque ordinateur vendu soit 105 dollars. La partie délocalisée sera composée de l’écran plat qui sera fabriqué à Taiwan pour un coût de 135 dollars et avec une marge de 10 % soit 13,5 dollars. L’équipement électronique et le clavier seront fabriqués quelque part en Chine, pour un coût de 165 $, supportant une marge de 10 %, (soit 16.50$). Conclusions, sur les 700 dollars, les marges laissées aux entreprises américaines seront d’environ 337 dollars. En revanche sur les 300 dollars imputables à la fabrication asiatique, la marge sera d’environ … 30 dollars ! Le modèle de la « plateforme » met à contribution une production « chip » délocalisée en laissant la créativité et la conception à forte valeur ajoutée intellectuelle dans les bureaux d’études, ce qui permet une forte augmentation de la rentabilité du capital investi, une réduction drastique de la part laissée au travail grâce à une meilleure organisation des facteurs de production. Pour Charles Gave, il est à peu près certain que ce modèle va continuer à se développer puissamment dans les années qui viennent. Chaque société industrielle ou commerciale soumise à la pression des coûts de production des pays en plein essor économique devra se spécialiser dans les secteurs où elle a une forte valeur ajoutée et laissera le reste à des sous-traitants. Ce redéploiement explique pourquoi la rentabilité du capital de la production est moins importante dans les pays producteurs[3]. L’ensemble des entreprises américaines qui ont investi des milliards de dollars en Chine ont des profits qui n’ont pas dépassé les 2,4 milliards en 2003, alors que celles qui ont investis en Australie ont engrangés quelques 7,1 milliards et celles qui ont parié sur Taïwan ont récolté 8,9 milliards de dollars[4]. Il est difficile d’affirmer le différentiel du coût du travail soit à l’origine de telles différences. Les failles logistiques, la faiblesse locale de la demande et du système bancaire aux particuliers et bien d’autres facteurs encore limitent le rendement du capital dans certains pays alors que d’autres offrent une valeur ajoutée immatérielle plus conséquente. Ce que l’on peut en dire c’est que la production reste – comme au bon vieux temps de la production agricole – le parent « pauvre » de la chaîne de la valeur. On l’observe en France encore aujourd’hui. Celui qui gagne sera celui qui saura optimiser son bénéfice fiscal et sa marge de distribution car la marge ce sont les intermédiaires commerciaux qui l’a font, comme toujours. Dans la réalité, la rentabilité de l’opération est presque complètement en faveur du maître d’œuvre qui détient le portefeuille clients, c’est-à-dire le réseau commercial. En d’autres termes les « économies d’échelles » vont à la production mais le bénéfice des « ordres de grandeur croissantes » vont à celui qui maîtrise la distribution. Ceci explique que les consommateurs occidentaux – qui possèdent le pouvoir d’achat – tirent parti du pouvoir de négociation de leurs multinationales. Un pouvoir d’autant plus important que leur travail reste très chèrement payé, alors que celui de l’asiatique ne l’est pas. Tout le monde y gagne, explique Charles Gave : les travailleurs des pays en développement, parce qu’ils ont du travail, les acheteurs occidentaux parce qu’ils obtiennent des prix plus attractifs alors que leur niveau de vie plus élevé tire une production des pays sous traitants beaucoup plus fortement que si elle était fabriqué aux Etats-Unis ou en Europe. De plus la rentabilité globale des capitaux investis devient plus intéressante:
- Elle est très peu cyclique : la partie cyclique (la production) a été affermée à des industriels étrangers.
- Elle est très élevée : le développement, la vente par l’Internet ne suscitent pas des besoins de fonds de roulement gigantesques. La rentabilité sur capital investi dans la distribution est donc très forte.
- Elle ne nécessite pas d’apports de capitaux frais : Dell est pour ainsi dire sans arrêt en état de cash-flow positif
- Elle est très visible : si le coût du travail augmente trop fortement au Mexique, Dell annule ou ne renouvelle pas ses contrats de production au Mexique pour en signer de nouveaux au Brésil, à Taiwan ou au Viêt-Nam…De ce fait, les prix à la production restent sous pression sans arrêt, réduisant ainsi l’inflation.
Un pays dans lequel un grand nombre de sociétés s’organisent sous ce nouveau modèle de la « plateforme » aura donc comme caractéristiques :
- une inflation en très faible progression, un boom de la consommation en volume, nourri par la baisse des prix des produits industriels importés et un déficit commercial énorme!
- une croissance économique centrée sur les services à forte valeur ajoutée, une forte création d’emplois dans les activités à forte valeur ajoutée (R&D) et dans la vente au grand public
- une extériorisation quasiment totale des emplois industriels a faible valeur ajoutée.
- des profits des sociétés représentant une part très importante et très stable du PNB … sous réserves que la spéculation financière soit jugulée.
Pour Charles Gave, les pays qui pour des raisons politiques (rejet de la globalisation) refuseront ce modèle de production verront leurs entreprises absolument laminées. Ils seront forcés de conserver des activités de production cycliques et peu rentables dans des zones où elles n’ont rien à faire. Ces réflexes cocardiers, qui n’appréhendent pas correctement la globalisation de nos économies, ne protègent pas les industries en danger et surtout, cela n’oblige pas les opérateurs nationaux à innover alors que les clientèles indigènes, captives, perdent en pouvoir d’achat faute de pouvoir profiter du phénomène « low cost » mondial. A terme, le protectionnisme ne les sauvera pas plus qu’il n’a sauvé l’industrie textile en France. Charles Gave remarque que refuser ce mouvement de globalisation, c’est aussi pratiquer le protectionnisme le plus vil, celui qui refuse aux pays émergents le droit de se développer. On voit mal au nom de quoi un gouvernement aussi attaché au développement durable et à l’aide au pays émergents (dans les discours) que le gouvernement français refuserait aux damnés de la terre le droit de se nourrir à leur faim et de trouver un travail qu’ils feront aussi bien que les salariés français et pour beaucoup moins cher, ce qui est tout à l’avantage du consommateur français. Pour Charles Gave, les conséquences macro économiques de ce nouveau type développement dans une économie globalisée sont immenses. Tout d’abord, il restructure complètement les marchés financiers alors que la part « pays émergents » dans les portefeuilles va connaître une croissance structurelle, puisque leur industrie est naturellement grosse consommatrice de capitaux et que la base industrielle du monde sera dans ces pays. Ensuite, un certain nombre de ces pays émergents seront directement dépendants de la consommation des Etats-Unis (dans ce cas précis). Ces pays vont donc avoir des excédents commerciaux considérables vis-à-vis des Etats-Unis, qui ne veulent strictement rien dire, puisque la maîtrise des flux (importations aux USA) est à 100% dans les mains de sociétés américaines. Et donc, demander à ces pays de réévaluer leurs monnaies contre le dollar ne réglerait rien. De fait, ils sont en zone dollar. La même chose se produira entre les nouveaux pays producteurs dans l’ex Europe de l’Est et l’Europe. Ce qui veut dire en termes simples que la balance commerciale d’un pays où les sociétés s’organisent selon les principes de la plate forme ne veut plus rien dire, ce qui ne manque pas de piquant quand l’on voit la baisse actuelle du dollar engendrée, parait-il, par les déficits de la balance commerciale… Effet pervers d’une trop grande dépendance des exportations en période de récession, l’avantage comparatif qui crée le déficit américain n’est pas en Chine, mais aux Etats-Unis. Ce sont les sociétés américaines qui domicilient ou elles le veulent le déficit US. Si le Yuan réévalue, Wal-Mart passera ses ordres au Vietnam, c’est tout. Le déficit US restera le même, mais il sera avec le Vietnam plutôt qu’avec la Chine, et le chômage montera en Chine. Mais refuser le partage de la valeur avec d’autres territoires est tout aussi périlleux. Il suffit pour s’en convaincre, nous dit Charles Gave, de considérer la bourse Japonaise : durant 12 ans les autorités Japonaises ont forcé les sociétés nipponnes à investir dans des secteurs ou le Japon n’avait aucun avantage comparatif. La rentabilité du capital au Japon s’est donc écroulée. Moyennant quoi, leur marché des actions s’est effondré. Mais les étrangers qui détenaient 20 % de la bourse Japonaise en 1989 n’en détiennent plus que 10%…et tout le monde s’est appauvri. Et Charles Gave de conclure : Mais les Japonais possèdent le capital national, qui soit dit en passant ne rapporte rien et donc personne ne veut. Le mercantilisme et le protectionnisme mènent toujours à la ruine, et il n’y a pas d’exemple dans l’histoire d’un pays qui ait été ruiné par le libre échange[5]. La démonstration de Charles GAVE n’est pas sans faille. Je note que l’excès de liquidités des « pays dollars » leurs permettront d’acheter une part croissante des sociétés américaines … comme quoi.
[1] Respectivement Odile Jacob 1993, et Village Mondial 2000
[2] C’est une révolte ? Non, Sire, c’est une révolution. L’intelligence prend le pouvoir, 2006 Bourin Editeur Charles Gave, Diplômé de l’université de Chicago en 1970, où il a passé un PhD en économie, il a été élève de Milton Friedman. Après un début de carrière en tant qu’analyste financier il a créé en 1974, l’entreprise Cegogest, spécialisée en recherche économique. Il est en 1986 co-fondateur de Cursitor-Eaton Asset Management. La société, qu’il quitta en 1999, fut vendue en 1995 à Alliance Capital. Par la suite il fonde à Hong Kong Gavekal, une société de recherche et de conseil en gestion de portefeuille. Il est membre du conseil d’administration de l’Institut Turgot, un think tank libéral[1]. Il collabora à la revue L’Esprit libre (1996).
[3] On aura compris que nous ne parlons pas de la spéculation du secteur financier
[4] China Economic Quarterly
[5] Les français croient toujours que les délocalisations sont à l’origine de la désertification de leur tissu économique. Elles ne représentent en 2007 que 0,35% de la mobilité de l’emploi soit environ 13 000 emplois alors que les investissements étrangers ont créé 45 000 emplois sur la même période.