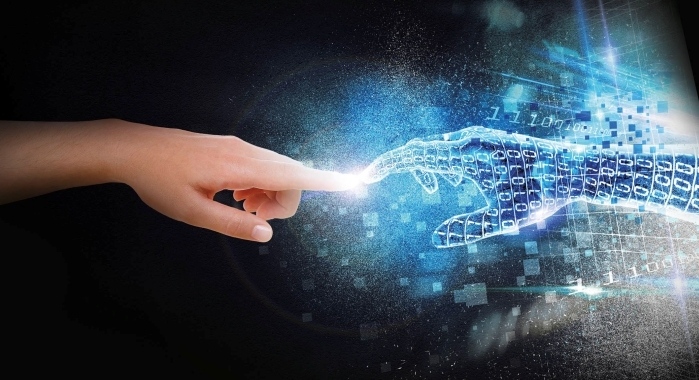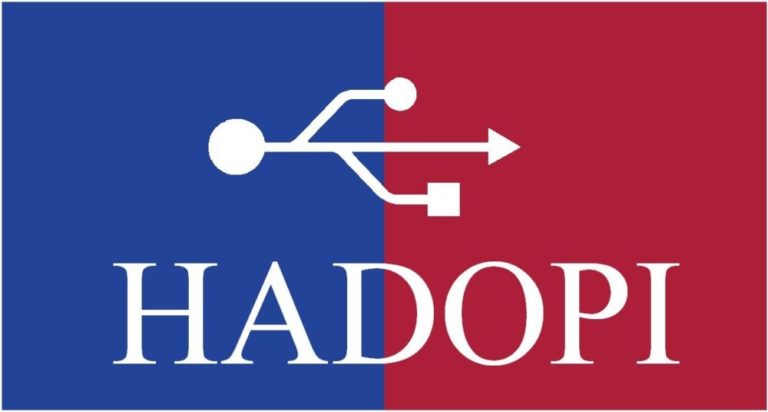Introduction par Denis ETTIGHOFFER
Le problème de la transformation du travail est posé depuis longtemps. Depuis aussi longtemps que des auteurs ont imaginé que les robots, que les machines prendraient la place des hommes. En général, la pauvreté de nos réponses a été affligeante. Une polémique plus ou moins larvée s’enflamme de temps à autre pour savoir si la diffusion des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) est un facteur propice à l’emploi ou au contraire un facteur de sa destruction. En 1993 une enquête de la SOFRES concluait que 54% de nos décideurs pensent encore que le chômage est dû aux nouvelles technologies. Les préjugés manifestes de certains arguments étaient une première justification à l’investigation que nous avons conduite depuis quelques mois. Mais plus important, à l’aube d’un nouveau millénaire, nous constatons que notre monde du travail n’a pas pleinement assimilé qu’il a subi, quasiment à son insu, une mutation structurelle dont il n’a pas encore mesuré et évalué la portée.
Nos industries d’abord fondées sur le rendement de la fabrication s’intéressent maintenant à devenir des organisations globalement efficaces fondées sur l’augmentation de la valeur ajoutée. La productivité de tels ensembles où la valeur ajoutée est dématérialisée, incorporée aux biens et aux services fournis, ne s’élabore pas selon des schémas néo-tayloriens car les sociétés modernes sont désormais caractérisées par une forte interdépendance économique, sociale et industrielle que renforcent les télécommunications. Alors que l’homme agit de plus en plus, à distance, sur des représentations du réel grâce à l’électronique, le travail s’installe dans des réseaux. Une part croissante de la population actuelle passe d’une logique de distribution du travail – des bassins d’emploi – à une logique de réseaux de distribution et d’échanges des savoirs. L’évolution considérable, depuis plus de dix ans, de la part consacrée aux investissements immatériels perturbe les idées que l’on se faisait sur la rentabilité du capital, sur la productivité.
D’une logique d’économie de production fondée sur l’accumulation de capital matériel propre à la deuxième vague, nous passons à une logique économique de co-production fondée sur l’accumulation collective de matière grise, de capital immatériel, spécifique cette fois de la troisième vague[1]. Un chambardement considérable des habitudes de pensée et d’action va accompagner cette évolution en remettant en cause notre vision du travail et des modes de travail. Chaque remise en question du monde du travail engendre l’inquiétude en ravivant des souffrances et des craintes latentes dans les organisations sociales. Pourtant le monde du travail mérite mieux que les discours lénifiants qui retardent la compréhension des mutations de notre société où les harangues apocalyptiques qui nous enferment dans une forteresse aux protections bien improbables. Au demeurant notre réflexion collective nous a permis de cueillir des fruits moins amers que nous ne le craignions au début de cette étude.
Notre démarche se veut modeste, mais quitter le port de cette frilosité et affronter les tempêtes du conformisme dérangé oblige à présenter de solides arguments sur les causes et les conséquences des transformations du monde du travail sous l’influence de la diffusion généralisée des réseaux et des ordinateurs. Question centrale qu’aborde cet ouvrage sans pouvoir, reconnaissons-le, être ni complet, ni exhaustif. Il nous fallait aussi naviguer au plus serré pour ne pas tomber dans le piège des phénomènes conjoncturels qui affectent l’emploi avec ceux, plus structurels, qui le transforment. La qualité de l’équipe qui a participé à la rédaction de cet ouvrage sur « Le Travail au XXIème siècle sous l’influence des réseaux et des ordinateurs », était une première garantie pour relever le défi d’une réflexion que nous voulions audacieuse sans être démagogique. A ce titre, je les remercie vivement de l’investissement personnel qu’ils ont bien voulu consentir pour participer à cette étude lancée par l’Institut en 1993. Tout comme nous remercions les sociétés qui l’ont soutenue : l’E.D.F., le S.F.I.B. et Bossard Consultants.
Autre difficulté de cette démarche, déceler les indices, encore faibles, qui agiront puissamment sur nos modes d’organisation du travail sans, par ailleurs, risquer d’inventer – un peu naïvement – un monde meilleur. Autant le rappeler d’entrée de jeu, les contraintes qui s’exercent sur nos organisations sociales s’inscrivent dans des logiques économiques et démographiques – comme le soulignera Hugues de Jouvenel – implacables. Des logiques économiques qui, au XXIème siècle, seront renforcées par le développement des effets des réseaux et des ordinateurs. Ainsi, on découvre qu’un réseau électronique devient un pays, une « nation virtuelle » qui fédérera des millions de ressortissants, avec ses lois propres en matière d’emploi et de partage des richesses. De quoi déstabiliser notre vision traditionnelle du monde du travail, dont une partie, les « networkers », s’installe déjà dans les réseaux.
Autres découvertes, au fil des pages, d’un travail dont les résultats, parfois étonnent et dérangent. A la question, « informatique, prédatrice ou nourricière ? ». La réponse d’Anne de Beer, est claire et sans ambiguïté : les Nouvelles Technologies de l’Information et la Communication créent des emplois. Et d’autant plus d’emplois que l’on accepte d’investir dans ces NTIC en les associant à des forces modernes d’organisation des services et des ressources humaines. Par contrecoup, nous découvrons des ressorts nouveaux à l’économie du travail. De binaire, avoir un travail ou ne pas en avoir, l’homme devient multiple, « polyactif » alors que les espaces et les temps de travail contraints sont remis en question. Selon Nicolas Bühler, le travail lui-même se tricote avec la formation. Cette dernière devient une « maintenance permanente » de ce nouveau capital – dit immatériel – que sont les savoirs humains. Elle offre une garantie supplémentaire « d’employabilité ». Mais elle a un coût, que seuls les réseaux et les métiers de l’ingénierie des savoirs, pourront maîtriser un jour, nous rappelle Jacques Perriault, pour qui les réseaux sont autant des réservoirs d’idées que de savoir-faire. Et que les NTIC exerceront sur leurs utilisateurs des comportements d’apprentissage afin de transformer ces idées et ces savoir-faire en moteurs de l’économie.
A condition aussi de maîtriser l’ingénierie des « transactions sociales », répond Pierre Lévy, pour qui, au milieu de ces techniques, l’homme reste plus que jamais le pivot de ce nouveau monde du travail. Il rappelle d’importance de savoir vivre et travailler ensemble pour gagner en efficacité globale. Pour lui la valeur ajoutée n’est pas une somme arithmétique d’individualités. Elle est collective, intelligemment collective, dans ces nouvelles organisations en réseaux. A condition encore d’accepter une nouvelle logique du travail coopératif – que favorise les NTIC – une nouvelle solidarité, qui ne soit plus simplement de classes sociales en voie de disparition, mais qui s’inscrive à des niveaux de co-responsabilité dans l’exercice du droit du travail, souligne à son tour Chantal Cumunel. La notion de « mineur » social s’atténue alors que s’affirme le droit à un mode d’emploi de sa vie où le travail et les activités socio-économiques s’entremêlent. Des formes de solidarités nouvelles, où les filières professionnelles organisées en réseaux pourraient être prépondérantes, brisent les castes sociales traditionnelles.
La contribution de Jérôme Oddon illustre, pour sa part, le rôle nouveau des associations ou autres organisations privées dans l’aide à la mobilité professionnelle, expériences considérées dans un premier temps comme des initiatives marginales pour personnes en risque de marginalisation économique et sociale. Il constate que ces organismes se multiplient compte tenu de la demande. Utilisateurs intenses des NTIC, ils sont en train de se placer au cœur même des besoins de gestion du partage des ressources, des compétences, comme le pratiquent un nombre croissant d’entreprises qui mutualisent leurs ressources humaines. Il bouleverse, avec quelques autres auteurs qui reprennent sa thèse dans ce livre, l’idée que l’on se fait d’une gestion endogène – dans l’entreprise – des ressources humaines.
Pour ma part, j’insiste sur le fait que le travail s’émancipe, passe d’une logique de salariat traditionnel à une logique de services rendus. Une mutation indispensable pour devenir un des membres d’une communauté virtuelle, un de ces millions de « networkers ». Nomades électroniques qui vivent et travaillent, voyageurs immobiles, grâce aux réseaux électroniques, en s’organisant en pôles, en réseaux puissants de compétences. Des réseaux de corporations professionnelles qui auront un jour, sans doute, une grande influence sur l’économie d’une région. Un phénomène favorisé par une « industrialisation croissante des services » comme l’éclaire bien Bernard Perret qui prévoit une baisse spectaculaire du coût des services propices à une nouvelle croissance économique, à l’accès à de nouveaux besoins marchands non encore satisfaits ; sans croire pour autant à une réactivation des mécanismes économiques propice au plein emploi.
Howard Rheingold, spécialiste de la réalité virtuelle, imagine, lui, les conséquences de la mutualisation croissante des hommes au travail avec les machines à simuler le réel. « Le partenariat homme-machine » fera du travailleur du XXIème siècle un « symbiote » interactif en réseau. Son intelligence sera branchée sur celles d’autres hommes ou avec des savoirs humains incarnés dans des ordinateurs formant de gigantesques communautés virtuelles. Elles inventeront une nouvelle cité en modifiant les rôles de la sphère publique. Un document fascinant sur les transformations opératoires du travail.
 Pourtant c’est le papier de Gérard Blanc sur « la répartition de la valeur ajoutée dans l’économie française » qui impressionne le plus. Ce texte, qui va à l’encontre de la culture française favorable à l’opacité des comptes, affirme que la cause de nos difficultés en matière d’emploi en France tient moins au coût unitaire du travail qu’à la structure particulière des prélèvements de la valeur ajoutée créée. La démonstration explique comment la part de la richesse créée par notre économie, et par nos gains de productivité, est structurellement confisquée à la force du travail par un État de plus en plus endetté et une sphère financière mondiale de plus en plus puissante. D’où des effets pervers qui affectent tout autant le pouvoir d’achat des familles que la capacité de la plupart des entreprises à créer de l’emploi et à se développer.
Pourtant c’est le papier de Gérard Blanc sur « la répartition de la valeur ajoutée dans l’économie française » qui impressionne le plus. Ce texte, qui va à l’encontre de la culture française favorable à l’opacité des comptes, affirme que la cause de nos difficultés en matière d’emploi en France tient moins au coût unitaire du travail qu’à la structure particulière des prélèvements de la valeur ajoutée créée. La démonstration explique comment la part de la richesse créée par notre économie, et par nos gains de productivité, est structurellement confisquée à la force du travail par un État de plus en plus endetté et une sphère financière mondiale de plus en plus puissante. D’où des effets pervers qui affectent tout autant le pouvoir d’achat des familles que la capacité de la plupart des entreprises à créer de l’emploi et à se développer.
Il ressort de ce livre, qui n’est pas une somme d’articles sur le « travail du futur », une réflexion cohérente sur les transformations d’une société en mutation. Une décomposition des anciens systèmes qui s’opposent encore à une recomposition de la société civile que j’interprète comme une véritable Renaissance. Chacun des auteurs, à sa façon, met le doigt sur des aspects essentiels, voire critiques, de ce que seront les nouvelles façons de travailler dans les années à venir sous l’influence des NTIC. Ils le font sans s’abstraire du contexte économique, social et politique des temps à venir. En cela leur travail prospectif, même s’il n’aborde pas la totalité d’un sujet immense, est remarquable. De ce point de vue, si le lecteur convient qu’un problème bien posé est déjà une bonne façon de le résoudre, il devrait, ici, y trouver son compte. Ce livre ouvre, en effet, quelques débats prometteurs sur les évolutions structurelles du monde du travail.
Référence : Le travail au 21e siècle sous l’effet des réseaux et des ordinateurs
https://manualzz.com/doc/5035483/travail-au-xxieme-si%C3%A8cle—ettighoffer-digital-campus
[1] Selon l’expression d’Alvin Tofler pour différencier l’époque industrielle et postindustrielle