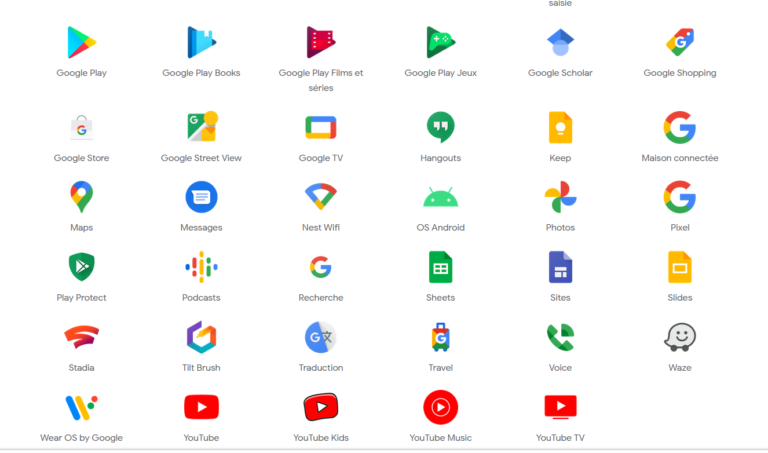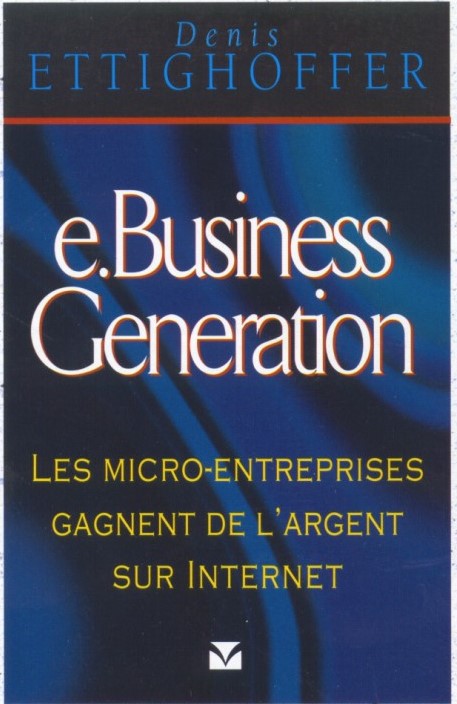J’étais engagé depuis de longs mois dans l’étude approfondie d‘une propriété de l’entreprise virtuelle « l’Omniscience, un concept derrière lequel se cachait tout un ensemble de paradigmes socio-économiques complexes. Un matin, je reçus un journaliste envoyé pour une émission sur les impacts de ces fameuses TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). Au détour d’une prise de vue, il acheva notre entretien par la question suivante : « Mais, à long terme, où tout cela nous mène-t-il ? ». Où cela nous mène t-il !? Sacrebleu, c’était justement la question que je me posais depuis des mois. Pourtant, à mon propre étonnement, ma réponse a fusé tout de suite : « Nous allons vers un monde plus économe en énergie ». Ma réponse spontanée, intuitive, cristallisait tout le travail auquel je m’étais attelé depuis des mois. Tout ce qui se passe dans l’actualité au jour le jour, tous les indices, toutes les données que je recueillais aboutissaient à cette idée force : les pays avancés amélioraient leur bilan énergétique, devenaient économe en énergie, en ressources matérielles et ils utilisaient, pour cela, les propriétés de la dématérialisation, des réseaux et des savoirs transformateurs.
Vers la fin des années 1980, avec « l’Entreprise Virtuelle et les nouveaux modes de travail[1]« , j’apportais ma contribution à ce que je considérais comme le début d’une formidable et passionnante aventure technique, économique et sociologique. A l’époque surgissait un nouveau paradigme de la vie des affaires et du monde du travail qui se définissait par trois propriétés données à l’entreprise grâce à la diffusion généralisée des réseaux d’ordinateurs: L’ubiquité ; la possibilité d’être virtuellement présent partout avec la déspécialisation des espaces de travail. C’était les débuts du télétravail et de la téléprésence. L’Omniprésence ensuite, qui permet la dérégulation des temps. On travaille d’où on veut mais aussi quand on veut. Propriété qui symbolise la rupture définitive de la frontière entre la sphère temporelle privée et professionnelle mais qui optimise aussi l’utilisation du capital de l’entreprise, à l’exemple des sites de prises de commandes ouverts 24 heures sur 24. Le don d’omniscience, enfin, d’où je tirais, en 1993, le concept du « campus virtuel » qui permettait d’accéder à la connaissance en « juste à temps », à la demande, à distance. L’ensemble de ces trois propriétés caractérisant selon moi une entreprise en voie de devenir virtuelle. D’autres ouvrages suivront abordant ces problématiques de façon plus détaillée et sous des angles divers[2]. On ne peut pas dire que le concept d’entreprise virtuelle soit difficile. Pourtant elle fait encore l’objet d’une grande incompréhension. Emmanuel Delataille, animateur talentueux d’émissions économiques me présentait comme « l’inventeur de l’entreprise invisible », ça amusait. Tellement de parrains se sont penchés sur son berceau pour lui donner une définition que l’on ne sait plus trop ce qu’il faut en penser. Pourquoi revenir là dessus!? Tout simplement parce que ces trois dons sont devenus l’ordinaire de n’importe quel individu, de n’importe quel groupe d’individus.
Tout internaute est désormais en mesure d’utiliser le don d’ubiquité pour voyager tout en restant immobile. Tout groupe de personnes peut être joint en permanence grâce aux technologies des mobiles. Des tas de gens entrent tous les jours dans la sphère d’accès aux connaissances « à la demande » grâce à la Toile. Voilà que fait irruption un « citoyen virtuel », l’internaute peuplant Netbrain, une planète numérique et savante. Aujourd’hui, grâce à la Toile un nombre sans cesse plus important de gens, de peuples, de nations peuvent bénéficier des retombées de ces dons donnés aux entreprises virtuelles : un immense potentiel d’économies des ressources s’offre à nous, à tous !
Toujours en parlant de l’entreprise virtuelle, j’ai soutenu en permanence que ce type d’organisation n’était pas que systémique, c’est à dire composé d’entreprises en réseaux d’ordinateurs interdépendants dans une entreprise étendue. Pour ma part il ouvrait à une autre interprétation possible : Coopérer avec un partenaire pour créer de la valeur (au plan production), modifier sa chalandise (au plan commercial) en limitant les coûts de représentation, coopérer avec des écoles, des instituts, des entreprises disposant de pôles d’excellences (pour mobiliser économiquement de la matière grise nécessaire à son développement[3]). Une posture que je considère plus favorable aux échanges d’idées, à la créativité des individus, car ce qui crée de la valeur n’est plus la partie physique du travail mais la composante relationnelle de l’activité de chaque opérateur humain[4]. C’est comme cela qu’il devient possible d’accéder aux idées et aux connaissances. Ce qui devient, comme le soulignait André-Yves Portnoff, aussi vital que de disposer de matériaux rares ou même de capitaux car nos connaissances permettent de remplacer telle ou telle ressource qui ferait défaut. D’où le développement des coopérations des « réseaux qui savent », conséquence logique du coût croissant du capital, de la matière grise et de l’obligation pour les entreprises de s’échanger des savoirs aux meilleurs coûts. Des savoirs qui permettront au dessinateur de réduire la quantité de matière utilisable, au chimiste de trouver l’enzyme qui facilite la dégradation d’un déchet, au métallurgiste de réduire la température d’un four pour un résultat toujours performant, au forestier de mieux gérer sa forêt. Dans une telle perspective, il était évident que les réseaux électroniques auraient un rôle majeur. Les échanges informels fertilisent les savoirs nés d’interactions entre cultures et fécondent de nouvelles innovations. Un anglo-saxon aurait parlé de « cross fertilisation », je parlais de « efertilisation ».
Reste un problème majeur. Malgré la qualité ou l’importance des réseaux en place, trop de réseaux d’entreprises existants se languissent dans des échanges protocolaires. Les dirigeants se posent la question de savoir pourquoi cette fertilisation se fait mal et comment mettre en branle ce mouvement brownien d’échanges d’idées et de savoirs indispensable à la créativité collective. Car l’affaire n’est pas simple ; s’attaquer au « don d’omniscience » de l’entreprise virtuelle, c’est s’attaquer aux problèmes de l’économie immatérielle des savoirs, au rôle que jouent les réseaux savants dans la libération des échanges des connaissances, marchands ou non. C’était aussi s’interroger sur notre patrimoine intellectuel et les façons à la fois de le valoriser et de le protéger. Autant dire que j’ai pris mon temps pour identifier les enjeux clés d’une guerre économique qui ne dit pas son nom et pour répondre à ces questions, parfois très complexes. A une époque où l’on lit « digest », où l’on « surfe » sur quelques pages pour s’informer superficiellement, j’ai longuement hésité à entrer dans le détail des caractéristiques d’une économie des idées et des connaissances, à bien des égards perturbantes. Ce qui m’a décidé en fin de compte, c’est la superficialité des avis recueillis ici ou là lors de mes investigations sur des enjeux économiques, sociaux et culturels pourtant essentiels. Avec pour résultat un livre si dense que nous avons décidé avec notre éditeur de proposer une partie du livre sous une forme numérisée.
Dans une première partie, « Netbrain, planète numérique « Low cost », j’ai souhaité montrer comment la digitalisation du monde aurait des conséquences profondes et durables sur la formation des prix et l’intensité concurrentielle d’un marché devenu mondial. Depuis quelques années, l’économie « low cost » fait sentir ses effets dans de nombreux pays sous la pression des pays émergeants. Avec la Toile, les réseaux offrent un pouvoir d’argent supplémentaire aux cyber-consommateurs tout en favorisant une pandémie du « low cost » affectant progressivement tous les compartiments de nos activités. D’entrée de jeu nous décrivons les multiples mécanismes de la vie « Low cost ». qui affectent les modèles économiques traditionnels et qui vont agir profondément sur « l’éco-efficience » du futur. Il s’agit de consommer moins de matières premières tout en produisant autant de biens et de services. Nous entrons pour de longues années dans un cycle d’éco-efficience rendu possible par la numérisation du monde. Nos sociétés utilisent les réseaux afin de substituer les déplacements numériques aux déplacements physiques, l’immatériel au matériel, les biens numériques aux biens tangibles. Les savoirs désormais disponibles dans les réseaux contribuent à améliorer notre bilan énergétique, à réduire notre « empreinte écologique » c’est à dire nos consommations.
Nos modes de vie et de travail vont devoir bouger tout en préservant autant que possible nos conditions de vie et de confort. Plus d’un milliard d’individus sont déjà en ligne avec la possibilité de tisser des collaborations, des relations plus ou moins suivies. Voici venue la revanche du « maillon faible » sur les automatismes informatiques. Ces maillons faibles ce sont des hommes et des femmes imaginatifs, des milliers d’internautes créatifs et savants qui fécondent la planète. Au Sahel, je puis, par la seule prévention, éliminer des maladies et des misères qui coûtent, sinon, des fortunes. Différemment, en Argentine, je puis reconvertir une agriculture qui détruisait les forêts en un marché du soja pour les besoins de la Chine. Cela et des millions de choses encore, sont rendues possibles grâce aux savoirs qui circulent dans les réseaux et qui permettent d’économiser d’immenses ressources matérielles. Les habitants de cette planète numérique disposent d’un pouvoir considérable, sans doute unique dans l’histoire. Certains comptent bien les utiliser pour « refaire le monde » et l’influencer durablement. Comment ? En utilisant les réseaux comme vecteur d’essaimage d’idées et de propositions, comme vecteurs d’échanges d’expériences et de recherches partagées. En repoussant les limites de l’économie et des rapports marchands traditionnels, en remettant en cause le rôle des monnaies, en redessinant la géographie de pays qui deviennent pour partie virtuels, en inventant collectivement des voies modernes aux modèles coopératifs, avenir du développement durable. Pour les internautes, le libre échange des idées et des savoirs sera la grande idée du siècle. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette première partie de mon livre.
Dans une seconde partie, « Réseaux savants : Planète Fertile » nous verrons qu’Internet ne sera pas uniquement un « réducteur des coûts énergétiques ». Il sera aussi le moteur de l’économie des connaissances, le premier levier de la vente de nos savoirs. En 1986, le fameux rapport du MIT sur les défaillances de l’Amérique en matière de développement technologique : intitulé « Made In America », a eu un intense retentissement sur la classe dirigeante du pays[5]. Dans le rapport du MIT le pouvoir exécutif américain était accusé de ne pas savoir gérer la technologie et la R&D face à la déferlante des produits et des innovations japonaises. Le constat mettait en évidence la mauvaise organisation structurelle de l’Etat américain pour promouvoir la technologie du pays. A l’époque, la question n’était pas de savoir si l’Amérique était en déclin en matière de connaissances. Elle ne manquait pas d’atouts. Le problème était qu’elle ne disposait pas de mécanismes favorables à la valorisation de son immense capital immatériel pour le transformer en « business », pour passer de la recherche à la commercialisation. La France est aujourd’hui placée devant le même problème. Il nous faut admettre que la recherche c’est du « business » ! Les règles du jeu changent. Les universités deviennent productrices de valeur. Avec ses licences, l’University of California System produisait en 1991, près de 19 millions de dollars en royalties. Cinq ans plus tard, en 1996, ce chiffre montait à plus de 63 millions de dollars, suivi de Stanford qui alignait la même année presque 44 millions de dollars. Le marché des licences représentera plusieurs milliards de dollars dans moins de vingt ans. Des années de sous investissements, d’attentisme des pouvoirs publics en matière de R&D font que nous partons avec de gros handicaps qui ne sont pas que financiers. Nos universités, nos « usines à savoir », sont désormais soumises à la concurrence internationale. Chacun doit comprendre qu’exporter des savoirs et des idées devient au moins aussi important que d’exporter nos avions ou nos TGV. Les savoirs transformateurs sont à la connaissance ce qu’est le pétrole à l’industrie pétrochimique, un composant de base, qui ne trouve sa vraie valeur ajoutée qu’après transformation. Il faut identifier les gisements d’informations importantes et savoir les transformer en connaissances à valeur ajoutée. Le savoir une fois transformé constitue une matière marchande à forte valeur ajoutée, qui s’échange ou se vend. Mais saurons-nous devenir une nation féconde et faire en sorte que nos entreprises le soient aussi ? Des savoirs, des biens numériques, qui se volent aussi, comme nous le verrons. Cela nous impose de faire évoluer notre perception de la révolution économique en cours.
Le Forum de Davos 2006 avait pour thème « l’impératif créatif ». Lors de son discours d’ouverture, son fondateur, le professeur Schwab, a fustigé le mépris des idées et argumenté pour «une économie fondée sur les idées et la capacité à les mettre en œuvre »[6]. Tout le monde sur le pont ! Nous devons devenir de vrais producteurs d’idées. L’innovation est d’abord un état d’esprit. Le rayonnement culturel de la France n’a jamais cessé de diminuer depuis des décennies. Cela n’est pas le fait d’une faiblesse de la « langue », c’est le fait d’un déficit de créativité. Au «siècle des lumières » la force de la langue française tenait à la force des idées qu’elle véhiculait. Aussi nous faudra-t-il avoir des idées, beaucoup d’idées, de la jeunesse, de la folie, un peu, et de l’audace, beaucoup. Dans un contexte de mondialisation des affaires et de concurrence exacerbée, de plus en plus de responsables d’entreprises européennes prennent conscience qu’ils ne peuvent pas se battre sur le seul plan de la diminution des coûts. Le défi est de favoriser les échanges d’idées et l’innovation. La réponse aux exigences de « créativité collective » ne se fera pas sans bouleverser les façons de penser le management d’hommes organisés en réseaux professionnels et sans revoir les façons d’organiser l’accès à des ressources immatérielles de plus en plus partagées. Les entreprises devront absolument libérer et encourager les échanges d’idées dans les réseaux et gérer des processus de constitution des banques d’idées. Les dirigeants devront reconnaitre leur personnel comme élément premier de leurs actifs immatériels. Car c’est cela notre capital aujourd’hui. Un capital immatériel, gigantesque, qui donne aux pays qui pétillent d’idées la chance de fertiliser le monde, d’innover, en s’enrichissant.
Une évolution majeure des avantages comparatifs entre nations et entreprises est en cours. Si nous ne nous réveillons pas, nos compétiteurs vont aller démarcher nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs avec des idées nouvelles, des projets de développement, des entrepreneurs de talents, de l’argent. En France les investissements vont continuer à se raréfier lentement faute de projets. Nos enfants iront voir à l’étranger si leurs idées et leurs énergies ne peuvent pas être mieux employées. Il est difficile de se faire une idée précise des multiples changements qui accompagnent l’entrée de nos pays dans l’ère du quaternaire où économie des connaissances. Savons-nous valoriser le capital d’idées de nos collaborateurs ? Savez-nous les rémunérer ?! Cette question sur la récompense de la créativité des salariés, s’accompagne, avec les nouvelles logiques de l’économie immatérielle, d’une remise en question fondamentale des ukases de la productivité du travail vue par les économistes du 19eme siècle. L’intensité des échanges sera le nouveau critère de productivité de l’économie immatérielle et de l’intelligence en action. Après des décennies d’étude sur les facteurs de productivité du travail et du capital, les sociétés modernes vont devoir s’interroger sur les bonnes pratiques relatives à la productivité des échanges. Les méthodes de production d’idées et de création de valeur ajoutée conjuguée n’ont rien à voir avec les méthodes connues de productivité. Cette valeur dépendra de la qualité des relations établies par les porteurs de talents, dans et hors de l’entreprise avec leurs partenaires et ses clients. Dans l’entreprise en réseau nous passons d’une logique des fonctions à une logique de la relation.
Dans une troisième partie, « Les Batailles des Nations Savantes », j’embarque mes lecteurs sur le champ des batailles à venir qui opposeront violemment les partisans de l’économie des biens numériques communs et ceux des biens numériques privés. J’ai rédigé, parfois avec la rogne de celui qui voit l’accident arriver sans pouvoir y faire grand chose, une chronique sur le devenir de l’économie et de la marchandisation des savoirs. Une économie des contenus dont nous risquons à tout moment de nous faire « exproprier » par les opérateurs détenant le monopole de la distribution et des échanges des biens numériques. Les acteurs n’y sont en rien d’innocents mais, plus important, beaucoup trop de nos dirigeants n’en comprennent pas encore les ressorts. Idéalistes s’abstenir. Le misérabilisme indécent des éditeurs et les prétextes pour préserver leur monopole de la distribution des biens numériques, masquent des enjeux autrement importants dans ces batailles entre nations savantes. La compétitivité pour s’emparer des ressources de matière grise et des réseaux savants nécessaires à l’économie des savoirs ne sera pas moins âpre que celle que nous avons connue pour s’approprier des matières premières ou conquérir des territoires. Vous découvrirez, tout comme moi, combien le sujet est complexe, aux ramifications étendues, parfois inattendues.
Face à ces nouveaux défis, les entreprises ne sont pas réellement prêtes à profiter de l’économie numérique. Dans une civilisation où le signe domine peu à peu la matière, ils sont des centaines de millions déjà, enfants, femmes ou hommes terminaux, qui se lèvent et se couchent devant un écran qui ferme l’accès à leur vie sociale et professionnelle. Pourtant, ces générations du numérique ne trouvent pas dans leurs entreprises, auprès de leurs dirigeants, les outils et les pratiques qui font déjà l’ordinaire de leur vie. L’avance de la société civile sur les institutions et les entreprises devient générale. Pourquoi ce qui passionne des millions de jeunes gens et des internautes précurseurs n’affecte-t’il que marginalement le fonctionnement des entreprises ? Ces outils du lien social déjà largement utilisés dans notre société n’étaient pas utilisés dans trois entreprises sur quatre en 2003 selon un sondage engagé par Eurotechnopolis Institut et l’Institut de Gestion Sociale[7]. Lorsque les entreprises mettent, difficilement, en place des groupwares et autres logiciels collaboratifs, des millions de jeunes et de moins jeunes utilisent déjà des jeux virtuels en ligne où ils se défient, discutent, se battent (ou font semblant), gagnent des points, des territoires, des armes ou des dons magiques, qu’ils vendent, échangent ou utilisent au gré du jeu. Les blogs sont déjà partout là où, dans les entreprises, l’on discute encore de savoir si libérer la parole (et l’écrit) n’est pas un risque incontrôlable. Les forums sont l’ordinaire de la vie des internautes et la téléphonie sur la Toile regroupe plusieurs millions d’utilisateurs mais on tremble chez nos dirigeants de l’audace d’une société civile sans « ingénieur système ou ingénieur sécurité ».
Il est encore temps de revenir sur le devant de la scène et de gagner un « pole position » internationale en matière de netéconomie. Mais à condition d’agir vite et sans complexe de façon à envoyer un message fort à la communauté scientifique et aux entreprises internationales. Pour limiter l’expatriation de ses talents, pour tirer le meilleur parti de l’économie des connaissances tout en rattrapant le temps perdu, la France doit devenir un vrai paradis fiscal pour les actifs immatériels, la R&D et les formations supérieures qui partent à l’étranger. Elle doit s’armer pour faire face à une compétition fiscale qui ne fait que commencer qui obligera certaines nations à reconsidérer leur modèle économique. Nous avons déjà manqué un rendez-vous historique avec les industries multimédias insuffisamment soutenues et notamment avec celui des industries de la simulation. Un secteur phare du XXIème siècle, qui enrichit aujourd’hui les concepteurs des réalités virtuelles appliquées à de très nombreux domaines[8]. Nous sommes en danger maintenant de manquer celui des services en ligne et notamment des services de la formation à distance. Nous sommes en guerre de l’intelligence. Une « guerre » ne fait pas dans la dentelle. Il faut cesser de mener une guerre des biens immatériels comme on dirige une administration. Nous sommes face à des milliards d’euros de contrefaçon, des milliards d’euros de licences détournées, des milliards de droits des biens communs tombés dans l’escarcelle de sociétés privées, des milliards d’euros de R&D qui s’investissent ailleurs qu’en France, des milliards d’euros cumulés de formation de scientifiques partis enrichir des sociétés étrangères. Nous perdons nos positions dans une netéconomie dont nous n’avons pas compris suffisamment tôt l’influence qu’elle aurait sur notre destin collectif.
Pour la première fois dans l’histoire humaine, la coopération massive d’individus de toutes origines à travers le temps et l’espace est soudainement facile et économique. Devenu auto-producteur, l’internaute substitue à l’image du spectateur ou du téléspectateur passif, l’image d’un individu qui entre en action ou en réaction aux histoires du monde. Les internautes deviennent, pour une part croissante d’entre eux, les acteurs d’une société numérique de nature libérale. La Toile désenclave les individus de beaucoup d’inhibitions. Elle permet l’échange et le partage des opinions, la confrontation aussi. Les cyber-citoyens forment l’essentiel des « réseaux d’affinités » qui agissent de façon concertée y compris pour créer de toutes pièces un pays virtuel cristallisant une communauté spécifique. Nous assistons à l’avènement d’une économie coopérative basée sur les rapports relationnels dans le but est de constituer une richesse utile à tous et à chacun. Ces réseaux débordent largement les frontières naturelles de l’entreprise et des régions pour constituer des communautés d’expertises transnationales plus ou moins formelles. Elles deviennent de véritables puissances économiques et politiques et n’hésitent pas à envisager de constituer de toute pièce un pays virtuel pour y défendre leurs intérêts. Dans la conduite des affaires de ce monde là, la politique des territoires traditionnelle devra être associée à une politique par projets.
Vingt cinq ans après avoir lancé un voyage vers l’entreprise virtuelle, je vous propose le projet d’occuper massivement une nouvelle « Terra incognita », Netbrain. Une planète numérique qui nous offre une formidable chance de rattraper le temps perdu. D’offrir aux plus vifs et aux plus audacieux un nouveau monde numérique à faire fructifier. La France va devoir identifier, développer et défendre les facteurs clés de son rayonnement face à des concurrents qui, grâce aux réseaux savants, entrent, eux aussi, dans l’économie des « savoirs transformés ». Mais nous ne serons pas seuls dans cette compétition ! Les réseaux savants se sont mis au service des neurones où la matière grise comme les idées deviennent les moteurs des « pôles positions » à prendre dans le concert des nations. A la sortie de ce livre sur l’économie des biens numériques vous ne verrez plus, vous ne lirez plus, vous n’interprèterez plus de la même façon les nouvelles d’un front invisible, celui de la bataille des nations savantes.
Denis Ettighoffer – Décembre 2006 – Netbrain, Prix de l’économie numérique 2008
[1] Paris, Éditions. Odile Jacob, 1992 ; Éditions d’Organisation 2000.
[2] Voir site www.ettighoffer.com
[3] Voir « Méta-@rganisations » Paris, Village Mondial, 2000, Prix Turgot.
[4] André-Yves Portnoff a co-rédigé La Révolution de l’intelligence (éd. Science & Techniques, 1983-1985), premier ouvrage francophone analysant l’entrée dans une nouvelle ère où ces facteurs, les connaissances, les talents mais aussi les valeurs, les passions, deviennent plus déterminants que les ressources physiques et financières qui avaient dominé la Révolution industrielle.
[5] Edité en France par Inter Editions, Paris, 1987
[6] Jean-Pierre Robin, Le Figaro du 8 janvier 2006.
[7] On trouve les messageries, l’accès à internet, et les moteurs de recherches. Mais pas les téléréunions, les forums de discussions, encore peu les portails employés, les communautés de travail, le bureau virtuel, l’utilisation des blogs,
[8] http://www.eurotechnopolis.com/fr/bookstore/lettre08.html