
J’ai eu l’idée de travailler ce concept du « droit d’usage opposable au droit de la propriété » le jour où un ami peintre est venu me voir, un peu inquiet avec la question suivante. « Dis-moi Denis, j’ai peint toute une série de tableaux sur le thème du Jazz. Pour m’inspirer, j’ai utilisé des photos des musiciens. Puis-je exposer mes toiles sans risque d’être poursuivi pour avoir enfreint le copyright du photographe?[1] » Combien d’entre vous savent répondre à cette question ? Combien d’entre vous avez conscience des absurdités de notre droit ? Absurdités qui freinent la croissance d’une économie qui nous font entrer définitivement dans l’économie de l’usage. Je m’interroge de savoir combien d’élus, de députés se sont donnés la peine de lire l’édition française de l’ouvrage de Lawrence Lessig « Culture Libre » ou « comment les éditeurs utilisent la loi pour confisquer les œuvres de l’esprit ». Un ou deux sur 600 députés ? Une dizaine de leurs collaborateurs ? En tous cas, vu l’inertie des pouvoirs publics face aux nombreuses dérives du copyright, on est en droit de se demander si les élus ont pris conscience des enjeux en cause.
Les connaissances sont des coproductions qui n’ont pu prospérer que grâce au « copyleft ». Les fables de Jean de la Fontaine se sont souvent inspirées des récits d’Esope, toute l’industrie du cinéma de Walt Disney se fonde sur les récits de légendes et des contes d’auteurs comme Andersen, les frères Grimm et bien d’autres. Etaient-ils des contrefacteurs !? La majeure partie des avancées scientifiques s’est appuyée sur des générations de chercheurs. Sont-ils des pirates ?! C’était une époque où les droits du copyright ne dépassaient pas trente ans (ils ne dépassaient pas quatorze ans en 1710). C’était une époque où les majors n’existaient pas encore et où l’espace public inventait en permanence des produits dérivés d’œuvres de l’esprit antérieures. Les gens partageaient la création de biens immatériels qui fondaient leur culture, constituaient un patrimoine commun. Ce peut être des histoires, des légendes, des chansons, des films, des recettes ou des logiciels mais des contenus accessibles à tous. « Pensez vous sérieusement que Shakespeare serait mieux connu si un organisme central de gestion des droits était un passage obligé pour tous les producteurs d’Hollywood qui s’en sont inspirés ? » s’interroge Lawrence Lessig. Aujourd’hui les industries des médias contrôlent soigneusement les utilisations de ce qu’elles considèrent de leur droit de propriété exclusif. Il s’est ainsi constitué une pratique d’exigence de « permission » pour quiconque envisage de s’inspirer d’une œuvre antérieure[2].  La préface de Fabrice Epelboin pour l’ouvrage de Lawrence Lessig résume bien la situation actuelle, « le copyright est aujourd’hui devenu une menace majeure pour la Culture, pas pour les industries de la culture ». La révision du copyright régulant la propriété des œuvres de l’esprit devient une ardente obligation pour un pays qui entend assurer sa croissance future dans l’industrie de la connaissance. Ce n’est pas une demande de droit au pillage, ce n’est pas une demande de gratuité, ce n’est pas une demande pour réduire les revenus des ayants droits et des industries des médias. C’est une demande de révision des absurdités et des dérives du droit imposé aux usagers de la culture et des savoirs. Les droits du copyright commencent à être utilisés afin d’étouffer la diffusion d’informations compromettantes ou gênantes. Les cinéastes enquêteurs sont sans cesse confrontés à l’interdiction de filmer ou de diffuser des séquences aux prétextes de protéger le droit à l’image. La presse traditionnelle mais aussi des entreprises tentent d’intimider des auteurs de blogs qui utilisent des liens vers leurs sites, leurs photos ou des flashs afin d’assécher les commentaires et les contributions qui les dérangent.
La préface de Fabrice Epelboin pour l’ouvrage de Lawrence Lessig résume bien la situation actuelle, « le copyright est aujourd’hui devenu une menace majeure pour la Culture, pas pour les industries de la culture ». La révision du copyright régulant la propriété des œuvres de l’esprit devient une ardente obligation pour un pays qui entend assurer sa croissance future dans l’industrie de la connaissance. Ce n’est pas une demande de droit au pillage, ce n’est pas une demande de gratuité, ce n’est pas une demande pour réduire les revenus des ayants droits et des industries des médias. C’est une demande de révision des absurdités et des dérives du droit imposé aux usagers de la culture et des savoirs. Les droits du copyright commencent à être utilisés afin d’étouffer la diffusion d’informations compromettantes ou gênantes. Les cinéastes enquêteurs sont sans cesse confrontés à l’interdiction de filmer ou de diffuser des séquences aux prétextes de protéger le droit à l’image. La presse traditionnelle mais aussi des entreprises tentent d’intimider des auteurs de blogs qui utilisent des liens vers leurs sites, leurs photos ou des flashs afin d’assécher les commentaires et les contributions qui les dérangent.
Qu’observons-nous en matière de Netéconomie ? Plus un réseau est fort, plus il est naturellement porté à vouloir dominer sa filière d’activité et à imposer sa loi en matière de distribution. Nous constaterons un phénomène similaire dans de nombreuses filières comme la pharmacie ou l’édition : Structures créatives d’un côté, puissants réseaux de distribution de l’autre. Il serait trop long de reprendre les nombreuses démonstrations de Lessig quant aux manœuvres des industries des médias pour préserver leurs monopoles. Mais l’histoire d’Edwin Howard Armstrong, l’inventeur de la FM qui se donna la mort après des années de lutte contre la RCA et la FCC pour faire valoir ses droits, donne froid dans le dos. L’histoire nous a enseigné que les innovations technologiques ont souvent contribué à déstabiliser les économies et les pouvoirs en place. Les industries des médias n’entendent pas se faire dessaisir de leur pouvoir d’intermédiation par Internet et quelques olibrius qui prôneraient la libéralisation des échanges des biens culturels et des connaissances. Il faut des décennies de combat et des dissidents qui se mettent hors la loi pour faire bouger une société. Pensez vous sérieusement que l’industrie de la photographie aurait pu se développer à la fin des années 1800 si Gorges Eastman, l’inventeur du procédé Kodak, avait été en butte comme aujourd’hui aux multiples lois règlementant jusqu’à la bêtise le droit à l’image et son partage. Partage qui a justifié le succès du Peer to peer du moteur Napster et d’autres moteurs d’échange plus tard.
Le droit d’usage doit pouvoir être opposable au droit de propriété. La propriété n’est plus nécessaire : il existe de plus en plus de services (prêts, location, leasing, multipropriété, trocs) qui relèvent plus du droit d’usage que de la propriété au sens premier. Un paradigme nouveau nous oblige à revoir nos postulats économiques. Au siècle des savoirs nous passons d’une logique propriétaire à une logique de l’usage. Un droit d’usage qui doit être rééquilibré par rapport aux droits de la propriété dans les domaines des œuvres de l’esprit. Avec l’irruption de ce nouveau référentiel de l’économie quaternaire, le risque est grand de voir l’économie des savoirs bloquée par une vision rigide de la transformation en cours des nouveaux leviers de croissance. Augmenter la durée des droits de copyright sur une œuvre de l’esprit aura été un détournement d’actifs immatériels au bénéfice des distributeurs. Il était suffisant de protéger l’auteur de son vivant et éventuellement ses ayants droits pour une durée raisonnable. Ce dispositif limite la capacité à faire circuler une œuvre ou un ensemble de publications qui ne seront jamais ou qui ne sont plus considérées comme rentables par le distributeur : ce qui revient à fossiliser une œuvre de l’esprit. Il est évident qu’il y a sur des points relatifs aux biens numériques mis en ligne une totale inadéquation des droits de propriété et des droits d’usage. S’oppose toute une culture pour qui la propriété est l’alfa et l’oméga de l’économie traditionnelle et d’autre part une culture de l’usage, même éphémère, des biens tangibles ou intangibles, immatériels. Avec l’économie quaternaire nous entrons définitivement dans l’économie de l’usage. Un nouveau monde aussi qui doit avoir ses arbitres. Des arbitres éclairés qui doivent s’interroger : avons-nous le droit de bloquer l’utilisation des biens immatériels existants sous prétexte de droits de copyrights abusifs ? Les œuvres de l’esprit doivent faire l’objet d’un soin attentif de protection contre toute confiscation tout en préservant le droit à la récompense de ce qui relève d’un véritable apport inventif. Une inventivité qui a souvent fait l’objet de poursuites pour avoir dérangé les systèmes établis. Comme pourrait en témoigner Jesse Jordan étudiant de Rensselaer Polytechnic Institut (RPI) à Troy dans l’Etat de New York. Elève programmeur, ce dernier va, dans le cadre de ses études, améliorer le moteur de recherche du réseau de son école. Le réseau est relié à internet. L’amélioration apportée par Jesse Jordan permettait de savoir quels contenus sont disponibles sur le réseau des ordinateurs des élèves de son école. Le problème vint du fait que les ordinateurs des élèves contenaient en plus des documents dédiés aux cours des fichiers d’images et musicaux. Un jour d’avril 2003, le jeune homme apprit qu’il faisait l’objet d’une plainte de la RIAA ( Recording Industry Association of America) qui lui réclamait 15 millions de dollars pour violation des droits d’auteurs. La RIAA se contenta de ruiner l’étudiant, qui même avec le soutien de sa famille, ne pouvait supporter les frais d’un procès qui aurait pu démontrer qu’il n’avait rien fait de mal. En fait, ce qu’il faut décoder de cette histoire c’est la stratégie d’intimidation des lawyers américains. Une stratégie qui déborde largement des frontières américaines.
La propriété des droits ne doit pas donner tous les droits. Les éditeurs conduisent des stratégies qui contribuent à la rareté du bien immatériel pour en augmenter la valeur ou différemment pour se constituer une clientèle captive qui ne pourra exercer son droit à « consommer » un bien numérique que dans le cadre d’une communauté fermée. On passera, d’une exclusivité de la production à une exclusivité de la distribution, d’un marché ouvert à un marché fermé ! Chaque fois que vous achetez un CD, un livre, une copie d’un nouveau document scientifique, même un peu de Coca Cola, vous êtes à la bifurcation entre un produit et l’accès à la propriété intellectuelle de quelqu’un. Aujourd’hui, les éditeurs peuvent abandonner tout simplement une œuvre qui ne leur rapporte pas suffisamment et néanmoins imposer un droit de péage si par cas un auteur quelconque s’en est inspiré ! Il faut avoir à l’esprit que dans le conflit engagé entre ceux qui veulent préserver les « biens communs » et les tenants de la « marchandisation de toutes choses » il existe un fort déséquilibre au bénéfice des seconds qui pèse déjà sur la libéralisation de l’économie immatérielle jusqu’au ridicule. 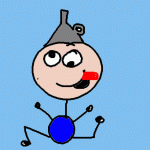 En 1996, l’Ascap, organisme américain équivalent à la Sacem en France, a intenté un procès aux Girls Scouts pour non paiement des chansons que les filles chantaient autour de leurs feux de camps. Impossible en France vont penser une majorité de lecteurs. Un point de vue que ne partageront pas forcément les spécialistes internationaux du droit qui ont déjà affrontés l’agressivité des cabinets anglo-saxons qui sont devenus une véritable machine de guerre. S’il convient de ne pas léser les auteurs/inventeurs il leur faudra aussi reconnaître comme le souligne Sophie Boudet-Dalbin, la part des droits qui reviennent à la société, à l’intérêt collectif dans une économie caractérisée par la coproduction généralisée des œuvres de l’esprit. Une coproduction qui n’est pas nécessairement monnayée dans une économie des savoirs que l’on qualifie aussi d’économie du lien, du lien social, nous rappelle certains auteurs. Auteurs qui, comme Lawrence Lessig et Richard Stallman, considèrent que la libre circulation des biens numériques doit être encouragée et facilité. Pour eux, les images, les clips, les blogs, les détournements des biens numériques pour en expliciter ou en détourner le sens, deviennent le nouveau langage des enfants et des adultes du XXIème siècle. Envisager un droit d’usage opposable, c’est reconnaître que le droit de propriété des biens immatériels ou numériques ne peut empêcher leur circulation, leur distribution, leur échange en contre partie d’une sanction tarifiée. Tout le problème alors se concentre sur le « tarif ». Comment y parvenir alors que la proposition de la licence globale a été refusée. Un vrai casse tête. Nous devons être attentifs à protéger les droits de création et d’innovation, sans jamais perdre de vue cette universalité des savoirs dont tente de s’emparer quelques intérêts très privés. La prospérité future de notre économie du savoir en dépend. Rien ne s’oppose à une révision du droit qui protège les œuvres privées marchandes tout en limitant la confiscation de toute activité créative par des intermédiaires.
En 1996, l’Ascap, organisme américain équivalent à la Sacem en France, a intenté un procès aux Girls Scouts pour non paiement des chansons que les filles chantaient autour de leurs feux de camps. Impossible en France vont penser une majorité de lecteurs. Un point de vue que ne partageront pas forcément les spécialistes internationaux du droit qui ont déjà affrontés l’agressivité des cabinets anglo-saxons qui sont devenus une véritable machine de guerre. S’il convient de ne pas léser les auteurs/inventeurs il leur faudra aussi reconnaître comme le souligne Sophie Boudet-Dalbin, la part des droits qui reviennent à la société, à l’intérêt collectif dans une économie caractérisée par la coproduction généralisée des œuvres de l’esprit. Une coproduction qui n’est pas nécessairement monnayée dans une économie des savoirs que l’on qualifie aussi d’économie du lien, du lien social, nous rappelle certains auteurs. Auteurs qui, comme Lawrence Lessig et Richard Stallman, considèrent que la libre circulation des biens numériques doit être encouragée et facilité. Pour eux, les images, les clips, les blogs, les détournements des biens numériques pour en expliciter ou en détourner le sens, deviennent le nouveau langage des enfants et des adultes du XXIème siècle. Envisager un droit d’usage opposable, c’est reconnaître que le droit de propriété des biens immatériels ou numériques ne peut empêcher leur circulation, leur distribution, leur échange en contre partie d’une sanction tarifiée. Tout le problème alors se concentre sur le « tarif ». Comment y parvenir alors que la proposition de la licence globale a été refusée. Un vrai casse tête. Nous devons être attentifs à protéger les droits de création et d’innovation, sans jamais perdre de vue cette universalité des savoirs dont tente de s’emparer quelques intérêts très privés. La prospérité future de notre économie du savoir en dépend. Rien ne s’oppose à une révision du droit qui protège les œuvres privées marchandes tout en limitant la confiscation de toute activité créative par des intermédiaires.
Libérer les échanges des biens immatériels ne veut pas dire liberté de faire n’importe quoi! Et puis un jour, un évènement survient. Un procès devient symbole de deux époques qui se télescopent. Un homme prend une décision qui fait tout basculer. Ce jour là, (nous sommes dans les années 45) le juge Douglas de la cour suprême des Etats-Unis doit trancher dans un litige concernant la violation du droit de propriété qui oppose de nombreux agriculteurs de Caroline du Nord aux compagnies aériennes qui survolent leurs terrains. Ces derniers invoquent une loi qui stipulait qu’un propriétaire l’était des sous sols et des espaces aériens « jusqu’à l’infini ». Ce jour là, le maintien d’une telle doctrine juridique aurait bloqué pour longtemps le développement de l’aviation. En quelques phrases, le juge Douglas annula des décennies de droit foncier « Cette doctrine n’a pas sa place dans le monde moderne. L’espace aérien est public comme l’a déclaré le Congrès. Donner raison à des revendications privées sur l’espace aérien entrainerait la paralysie des lignes aériennes et compromettrait profondément leur développement. Cela reviendrait à privatiser un bien qui a vocation à être public. Le sens commun se révolte à cette idée ».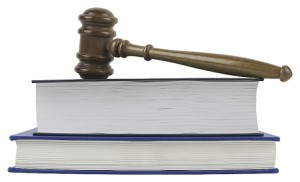
On pourrait – à tort – aboutir à la conclusion que la liberté offerte aux échanges de connaissances est un droit de tirage sans contrainte sur le patrimoine des communautés ou des nations savantes. Ce n’est pas le cas. Il convient de se méfier d’un idéalisme vite dogmatique du « bien commun » face à l’âpreté tout aussi dogmatique de la « marchandisation de toutes choses ». La première des difficultés est de gérer la migration d’un modèle traditionnel qui considère que toutes œuvres de l’esprit est un bien de consommation dont le destin dépend entièrement de ses distributeurs. Distributeurs qui restent propriétaires de l’œuvre en offrant simplement un « droit s’usage ». Contre ce droit d’usage, le futur utilisateur se devrait de payer une sorte de péage, de location d’une œuvre de l’esprit. Si cette location est concédée à titre gracieux, elle ne déroge en rien les droits de propriété. On parle de « droit d’auteur » pour la cession d’un exemplaire et de « licence » lorsqu’il y a une concession – le plus souvent géographique -complète cédée à une personne ou une entreprise qui loue le droit d’exploiter un bien numérique pour son compte exclusif et dans un cadre règlementé. Cette licence peut se négocier ; encore faut-il que son prix ne soit pas rédhibitoire pour les utilisateurs finaux. Si le Congrès américain a su le faire, pourquoi pas l’Union Européenne ? Pour ne pas freiner les échanges de biens numériques (livres, vidéos, fichiers de toutes sortes), il est impératif de rénover le copyright et ses modes de financement. C’est la raison essentielle pour laquelle nous devons rouvrir rapidement le dossier de la licence globale. Si j’ai des réserves sur le mode de financement proposé et une autre façon d’aborder la taxe à la consommation des œuvres de l’esprit, il reste impératif de trouver une solution qui préserve les créateurs, et assouplisse la circulation et le libre usage des biens culturels[3]. Les discussions sur la licence globale n’ont pas, de mon point de vue, suffisamment creusées la question des pouvoirs exorbitants qu’ont les majors et autres éditeurs dans une boucle où ils restaient aux commandes des droits de péage mais aussi de circulation des biens numériques. Droit privé majeur sur les patrimoines immatériels, droit moral sur les œuvres, droit économique (puissance économique devrais je écrire) que je leur conteste. La licence globale – qui propose un forfait sur les télé-consommations – se heurte sans doute au fait que les éditeurs ne maîtriseraient plus la tarification des licences dans un espace désormais sans frontières. Leur intérêt est de continuer à préserver « l’effet frontière » de leur marché traditionnel afin d’éviter la fuite d’une majeure partie de la diffusion de leur production. La situation actuelle préserve leurs marges à défaut de favoriser la croissance de leur marché. Ma proposition, analogue à l’idée de la consommation électrique, a l’avantage de créer un rapport entre l’importance de la télé-consommation personnelle des biens numériques et le palier du tarif à payer. Les détracteurs de cette approche ne m’opposent pas d’arguments sérieux. On peut s’interroger de savoir si l’OMPI a correctement estimé les enjeux de l’économie immatérielle et les clarifications à conduire avec les Etats Européens sur les biens communs ainsi que les évolutions à prévoir en matière de protection intellectuelle. Pour Lawrence Lessig, les conflits en cours et à venir mettent surtout en cause des multinationales puissantes qui conduisent des stratégies de maîtrise monopolistique des contenus et de leur distribution. Mais il ne perd pas confiance. A l’exemple des propriétaires terriens qui tentaient de toucher de substantiels dividendes des lois en vigueur, des entreprises chassent les rentes de situations de droits intellectuels, appuyées par des bataillons d’avocats, soutenues en sous main par leur pays d’origine. Au fait, vous ai-je précisé combien la RIAA demandait aux quatre étudiants qui furent accusés de violations du copyright ? Cent milliards de dollars, soit six fois le total des profits de l’industrie cinématographique en 2001[4]. En laissant s’opérer une concentration des pouvoirs aux mains des seules industries des biens culturels, des éditeurs, des médias, nous nous constituons un piège qui pourrait stériliser toute capacité à faire valoir notre créativité et à pouvoir en tirer parti. Ce qui nous ramène à la question de mon ami. Et à ma réponse : « Laisse venir. On trouvera bien un jour un juge Douglas qui, face à trop d’arrogance, saura répondre : Le sens commun se révolte à cette idée »[5].
DCE
[1] Pour voir l’histoire du peintre qui eut des ennuis pour avoir repeint le portrait photographié d’Obama. http://www.youtube.com/watch?v=lWMmC1LxOug
[2] L’ouvrage de Lessig multiplie les exemples de dérives aberrantes ignorées le plus souvent par le grand public et les élus. Petite dernière : Philip K. Dick était un auteur de SF talentueux et torturé qui aura écrit de nombreux ouvrages repris par l’industrie cinématographique et le théâtre. Une douzaine au moins. Il est mort en 1982 la même année où sortait Blade Runner inspiré par son livre : « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? ». Tous les autres films ont été tournés après sa mort. Dans Blade Runner, Harrison Ford courait après un androïde nommé Nexus6. Google a eut la mauvais idée d’utiliser le nom de « Nexus One » sans passer à la caisse pour le système d’exploitation de son portable Android. La famille attristée attend une compensation.
[3] J’y reviendrai en détail dans une prochaine contribution
[4] Voir l’ouvrage de Lawrence Lessig page 27
[5] Voir: http://translate.google.com/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.eff.org/riaa-v-people











